Un article essentiel. Depuis quelques années, l’espace extra-atmosphérique n’est plus un simple « objet de prestige », mais un champ à part entière et majeur des relations internationales. Les bouleversements sont multidimensionnels. Quentin Ghueho (1) nous propose dans cet article une belle mise en perspective, qui vous permettra d’accéder à la connaissance indispensable du champ spatial. Que disent les traités internationaux ? Qu’est-ce que le New Space ? Quel est le rôle de l’Etat ? Quels sont les risques des transferts technologiques ? Et même ce que l’on ne soupçonne pas de façon immédiate, l’étude des impacts environnementaux... L’espace n’est plus simplement « politique » mais est devenu un « outil géopolitique », en confrontation avec le droit international sur les conflits. (…)
ANALYSE INTERNATIONALE
LA TRANSFORMATION DE LA POSTURE DE DÉFENSE DU JAPON ET LE DÉBAT SUR LA DIMENSION NUCLÉAIRE DE L’ALLIANCE AVEC LES ÉTATS-UNIS. Marianne PÉRON-DOISE
« Dans les faits, le Japon serait très probablement le dernier pays d’Asie du Nord-Est à se doter de ses propres armes nucléaires... ». Depuis fin 2022, le pays est pourtant en pleine redéfinition de sa politique de sécurité. Par son expertise, Marianne Péron-Doise (1) nous fournit une analyse fine en rentrant dans le détail de la doctrine et de ses programmes. C’est une rupture à venir pour le Japon que l’on sait toujours très sensible à la question nucléaire. On lira dans cet article spécialisé les éléments de soutien à la stratégie Indo-Pacifique des Etats-Unis : hausse du budget de la défense, acquisition de missiles longue portée, nouvelle structure de commandement, partage nucléaire... L’interconnexion (inquiétante) des conflits en cours est désormais une donnée stratégique (…)
LES INSTANCES DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE ET DE SÉCURITE EN INDO-PACIFIQUE ET LEURS INTÉRETS POUR L’UE. Chloé BAMBERGER
Dans la région Indo-pacifique - entre les initiatives chinoises institutionnelles et les mesures occidentales - l’UE tente « d’exister » à partir de ses principes diplomatiques et de partenariat. La rivalité sino-américaine, l’arsenalisation des interdépendances et des échanges, tendent à accroître le lien entre la sécurité de l’Indo-Pacifique et celle de l’euro-atlantique. Notamment avec la présence accrue de l’OTAN... Chloé Bamberger (1) analyse ce vrai dilemme stratégique pour l’UE, largement divisée ou impuissante sur le sujet. Certains membres souhaiteraient préserver (construire...) une autonomie stratégique. On notera la place singulière et le rôle (incertain et menacé) de la France. Geopoweb publie aussi régulièrement des travaux de jeunes chercheurs.
(1) Chloé Bamberger est (…)
AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, QUELLE PLACE DE L’EUROPE DANS LE NOUVEL ORDRE GÉOPOLITIQUE MONDIAL ? Joséphine STARON
Les élections européennes du 9 juin ont affaibli les deux grands pays fondateurs (France, Allemagne) et par conséquent l’idée européenne, au moment où des « vents mauvais soufflent aux alentours de l’Europe » . Son modèle kantien et ses valeurs en ressortent affaiblis. Pourtant la lecture de cette dynamique s’avère plus nuancée. Joséphine Staron (1) nous propose une analyse claire et sans artifice d’un paradoxe : montée des populismes mais aussi attachement à l’U.E. Cette relation dialectique traduit in fine un besoin accru de sécurité - une Europe plus protectrice (aux dimensions qui restent à définir) et une nouvelle architecture de sécurité européenne (qui reste à construire). La résolution produira l’Europe de demain. Si les grands équilibres politiques européens n’ont pas été (…)
TRIBUNE - FACE À UNE CHINE BÉLLIQUEUSE, LE JAPON JOUE LA CARTE DU RÉARMEMENT. Pierre-Antoine DONNET
Pierre-Antoine Donnet (1) décrypte dans cette tribune les facettes d’un changement historique majeur qui bouleverse, suite à une inquiétante montée des périls, la position historique traditionnelle du Japon. Forces en présence, narratif des uns et des autres, dégel des relations avec la Corée du Sud, position de la société, scenarii… L’on sait que la Chine revendique une « souveraineté indiscutable » sur quelque 90 % des 4 millions de km² de la mer de Chine méridionale (réserves halieutiques et en hydrocarbures), une zone dans laquelle transite chaque année quelque 40 % du commerce mondial. Une mise en abîme qui concerne nombre de pays contestant les revendications chinoises : Philippines, Taïwan, Indonésie, Brunei, Malaisie, Vietnam
(1) L’auteur vient de publier « Japon, l’envol (…)
LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX CADRES DE COOPÉRATION DANS LA RÉGION INDO-PACIFIQUE - LES DÉFIS DU MINILATÉRALISME POUR L’UNION EUROPÉENNE ET SES PARTENAIRES. Chloé BAMBERGER
On lira avec grand intérêt l’article de Chloé Bamberger qui analyse « les enjeux multiples du minilatéralisme dans la région Indo-Pacifique ». Une région au coeur de défis économiques et militaires majeurs. Comment l’UE peut-elle jouer un rôle stratégique alors que les nations asiatiques renforcent leurs liens ? L’article examine en détail les partenariats stratégiques, les coopérations bilatérales et les accords de libre-échange entre l’UE et l’Indo-Pacifique. Il souligne ainsi l’impératif pour l’Europe d’adopter une approche équilibrée, tenant compte des intérêts divergents des acteurs...
(1) Chloé Bamberger / Analyste en stratégie internationale, diplômée d’IRIS Sup’, Mai 2024
LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX CADRES DE COOPÉRATION DANS LA RÉGION INDO-PACIFIQUE - LES DÉFIS DU (…)
DU DROIT DE LA GUERRE DANS LE CONFLIT ARMÉ RUSSO-UKRAINIEN. David CUMIN
Le droit tente de régir les guerres au moins depuis l’Antiquité. De façon générale, il aurait pour objectif de faire diminuer la violence, en particulier ses conséquences civiles. Mais le développement des nations et des technologies en reconfigurent complètement la portée. Dans cet article particulièrement documenté, David Cumin (1) analyse les implications du droit de la guerre ou des conflits armés dans le cadre de l’affrontement armé russo-ukrainien : « opération militaire spéciale », déclaration de guerre, belligérance, neutralité, responsabilité réparatrice, défense légitime, forces régulières et irrégulières etc... L’écart entre les règles et la réalité sur le terrain, les blocages institutionnels (CSNU, CPI...), illustrent toutes les difficultés à construire des principes (…)
LES YAKUZAS JAPONAIS. UN EXEMPLE LOCAL DE LA CONTIGUÏTE DU CRIME ORGANISÉ, DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA MONDIALISATION. Gaël MICOUIN
Dans cet article très documenté, Gaël Micouin (1), à travers l’exemple des yakusas japonais, fait entrer le crime dans le champ d’analyse de la géopolitique. Il s’agit d’une organisation composée de clans avec une hiérarchie pyramidale de type patriarcal. Comme on pourra en lire les raisons ci-dessous, c’est un phénomène social, politique et économique, qui aujourd’hui n’est pas seulement local. Les motifs d’exercice du crime sont internationaux, ainsi que les moyens de lutte que l’on découvrira plus loin. Bonne lecture !
(1) Gaël Micouin est en Master 2 « Affaires Asiatiques » de Sciences Po Lyon, il a appris le japonais puis le chinois. Il travaille sur une analyse comparative des criminalités organisées japonaises et chinoises en lien avec l’État et le nationalisme.
Dessin de (…)
BREXIT, COVID-19, QATARGATE, GUERRE EN UKRAINE - CE QUE LES ACTEURS DE L’UNION EUROPÉENNE FONT DES CRISES
On se rappelle la célèbre phrase de Jean Monnet : « l’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Il est particulièrement notable que « la séquence politique 2019-2024, correspondant au « quinquennat » des présidences des Institutions de l’Union européenne (Commission, Parlement, Conseil européen) ait été rythmée par un ensemble de « crises » ». À la suite de multiples enquêtes auprès des acteurs, les trois chercheurs (1) nous proposent dans ce bel article, une lecture des crises européennes avec une démarche de sociologie politique. Les crises européennes multidimensionnelles sont analysées comme une ressource pour construire de nouvelles politiques publiques. Une démarche scientifique qui se positionne en dehors des jugements et (…)
SIX MOIS AVANT LES ELECTIONS EUROPEENNES, L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE DOIVENT FORGER LE DISCOURS D’UNE EUROPE PLUS GEOPOLITIQUE. Jeanette Süß
Juin 2024 : élections pour désigner les députés au sein du Parlement européen et après ? Jeanette Süß (1) nous propose un article particulièrement documenté, qui va bien au delà du diagnostic habituel sur l’U.E (... qui se fissure avec le populisme, le désintérêt pour la chose européenne, l’apparition de nouveaux régimes illibéraux...), voire est prise au piège de dimensions (puissance et militaire) qu’elle avait laissées de côté avec « le plus jamais ça » et la philosophie kantienne de la paix. Une plus grande capacité d’action est nécessaire face aux enjeux des crises géopolitiques à sa porte et l’urgence d’enclencher une « transition environnementale juste » (Eloi Laurent).
En partant des situations politiques en Allemagne et en France, l’auteure pose de nombreux jalons sur les (…)
ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC EMMANUEL LINCOT sur la Chine et l’Asie centrale. « LE TRÈS GRAND JEU »
Dans son dernier ouvrage, Emmanuel Lincot (1) nous propose un parcours en Asie Centrale en « déseuropéanisant l’approche ». Le Très Grand Jeu. Pékin face à l’Asie centrale est d’une grande clarté analytique. Il est à noter l’organisation peu classique de l’ouvrage, qui offre une lecture souvent décalée à partir de différentes entrées : Imaginaires, Mythologies politiques et Patrimoine, le point de vue de Multiples Capitales et Acteurs (à l’intérieur et l’extérieur de la zone étudiée), Amis/Ennemis etc... On notera en particulier la redécouverte par l’U.E de cet espace longtemps fermé par le soviétisme (« Nouvelle stratégie pour l’Asie Centrale » juin 2019 »). L’auteur propose une analyse multifactorielle des interactions entre les différents acteurs d’une région, qui s’étend du (…)
ENTRETIEN AVEC HAMIT BOZARSLAN. DE L’ANTI-DÉMOCRATIE À LA GUERRE EN UKRAINE
Hamit Bozarslan (1) est historien, sociologue du fait politique et spécialiste des puissances autoritaires. Il a récemment publié deux ouvrages majeurs. « L’anti-démocratie au XXIe siècle. Iran, Russie, Turquie ». 2021. CNRS Editions (AD) ; « Ukraine. Le double aveuglement ». 2023. CNRS Editions (UKR).
Ces deux livres éclairent, dans le contexte que l’on connaît, les caractéristiques communes à ces trois régimes autour du concept d’anti-démocratie. De la Russie à l’Asie en passant par le Sahel, la guerre en Ukraine etc…, l’histoire contemporaine semble ajouter régulièrement de nouveaux exemples - véritables études de cas - confirmant la pensée de M. Bozarslan. L’analyse en tant qu’idéal-type des anti-démocraties, de l’hubris de certains dirigeants, nous interpelle sur nos propres (…)
EN EUROPE COMME À L’INTERNATIONAL, UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES POUR LE DUO FRANCO-ALLEMAND. Marie KRPATA
En 2019, Madame von der Leyen dévoilait le projet de la nouvelle Commission pour 2019/2024. Elle affirmait que l’U.E devait désormais devenir un acteur géopolitique, signifiant la volonté et la capacité de se positionner sur les grands enjeux internationaux, singulièrement dans les rapports de puissance. Entreprises stratégiques, question climatique etc... un abandon en somme de la naïveté du simple laisser-faire ! Le contexte actuel de bouleversement de l’ordre mondial en précipite le désir initial. Dans ce bel article, Marie Krpata (1) analyse la multitude des défis que le duo franco-allemand (« amitié, couple, duo... ? ») doit affronter : redéploiement des chaînes de valeur, relations avec le flanc Est, choix du matériel militaire, divergences ou retardement sur les livraisons (…)
ENTRETIEN EXCLUSIF - LE MULTILATERALISME AU PRISME DE NATIONS DESUNIES. Julian FERNANDEZ
ENTRETIEN EXCLUSIF - LE MULTILATERALISME AU PRISME DE NATIONS DESUNIES. Julian FERNANDEZ
Depuis 1945, le multilatéralisme a souvent été perçu comme un instrument de progrès permettant de dépasser l’approche réaliste et purement anthropologique du chaos originel dans les relations internationales. C’est une dialectique entre coopération et compétition, aboutissant à un construit juridique et politique des interrelations entre les nations. Aujourd’hui le multilatéralisme universel est en crise. À travers cet entretien exclusif, avec une grande acuité et des exemples-clefs, Julian Fernandez (1) en analyse les racines, les ressorts dans un monde en plein bouleversement. En fin d’entretien, on trouvera la référence à un ouvrage collectif essentiel et bienvenu (2) dans un contexte de (…)
L’AFRIQUE ET LA CHINE : UNE ASYMÉTRIE SINO-CENTRÉE ? Thierry PAIRAULT
Dans cet article, Thierry Pairault (1) mène une réflexion nécessaire sur les mots et l’entendement habituel concernant les relations entre la Chine et l’Afrique. S’il n’y a pas « d’ Afrique globale » (mais une diversité de pays), pas plus que de « Chine homogène » (mais des acteurs institutionnels parfois s’affrontant), pas de « grand plan central » (mais des entreprises en mission stratégique), l’auteur réinsère au moins de façon relative les décisions des gouvernements africains. Avec le sens de la complexité systémique, Thierry Pairault pondère toutefois fortement ce fil directeur. Le retour de l’autoritarisme, l’instrumentalisation de l’humiliation et du Tiers-mondisme, traduisent une Afrique qui reste (trop souvent) un réservoir de ressources. La Twin diplomacy, les Nouvelles (…)
L’INDO-PACIFIQUE : UN CONCEPT FORT DISCUTABLE ! Thierry GARCIN
Thierry Garcin (1) prend le parti de laisser de côté la dimension « liens spécifiques entre les nations » pour s’interroger sur la consistance géographique et stratégique de la zone indopacifique, en s’appuyant sur la permanence des antagonismes et des retournements de situation. Il s’agit d’un construit assez hétéroclite avec des pays parfois historiquement éloignés, plutôt une stratégie qu’un territoire basé sur une vision respectueuse du Droit international. Une zone immense dans laquelle opèrent des logiques de double encerclement par deux puissances majeures. La Chine mobilise avec succès les nouvelles Routes de la soie (terrestres et maritimes). On lira avec un intérêt particulier les doctrines de la France, de l’Inde et … l’absence de l’UE.
L’équilibrisme géographique et (…)
L’ALLIANCE CHIP4 EST-ELLE NÉE OBSOLÈTE ? Yohan BRIANT
Yohan BRIANT (1) pose une question essentielle : « l’alliance Chip4, un assemblage de partenariats formels, pensé dans une optique de containment est-elle viable ? » La pandémie a révélé les déséquilibres de puissance après des années d’éclatement des chaînes de production et de délocalisations. La fin du monopole américain des semi-conducteurs et la montée en puissance de la Chine sur fond de remise en cause du droit international, portent la question centrale sur le plan sécuritaire et géopolitique. L’auteur tire le fil de cette analyse à partir des semi-conducteurs, qui bien au-delà du sujet brûlant sur Taiwan, met en cause la stabilité de l’ordre international et des alliances (en particulier dans l’indopacifique). On notera la position de la France dans cette aire et le (…)

 INVESTISSEMENTS DIRECTS A L’ÉTRANGER - D’UNE STRATÉGIE DE FIRMES À UNE STRATÉGIE GÉOPOLITIQUE (2ème partie). Laurent Izard
INVESTISSEMENTS DIRECTS A L’ÉTRANGER - D’UNE STRATÉGIE DE FIRMES À UNE STRATÉGIE GÉOPOLITIQUE (2ème partie). Laurent Izard
Dans cette deuxième partie sur le basculement majeur des investissements directs à l’étranger vers les enjeux géopolitiques, Laurent Izard entre dans l’analyse de l’Union européenne et de la France. La complexité est de trouver un équilibre : comment attirer les IDE étrangers tout en (re)construisant une relative souveraineté économique ? L’auteur insiste sur la difficulté de passer d’une « nouvelle doctrine » à l’efficacité de mesures effectives, dans une Europe fortement désindustrialisée, aux positions nationales souvent opposées.
L’Union européenne s’est bâtie autour de l’idée du « laisser faire-laisser passer » chère aux économistes libéraux, qui ne se limite pas aux échanges commerciaux mais concerne également les IDE. En dépit de cette doctrine non interventionniste, tout a (…)
 INVESTISSEMENTS DIRECTS A L’ÉTRANGER - D’UNE STRATÉGIE DE FIRMES À UNE STRATÉGIE GÉOPOLITIQUE. Laurent IZARD
INVESTISSEMENTS DIRECTS A L’ÉTRANGER - D’UNE STRATÉGIE DE FIRMES À UNE STRATÉGIE GÉOPOLITIQUE. Laurent IZARD
Les investissements directs à l’étranger sont sur le plan théorique, une illustration typique du libre échange, de l’ouverture croissante de pays historiquement de plus en plus liés de façon complexe par les intérêts notablement économiques. Toutefois l’on découvre que derrière l’attractivité (« forme de neutralité » ; « que le meilleur gagne »...), des investissements parfois de prestige, sont de plus en plus stratégiques, soulignant la montée des conflits et des enjeux géopolitiques. Laurent Izard (1) appuie son propos sur de nombreux exemples d’entreprises qui font système. L’approche permet de mettre à jour (au moins en partie) des choix souverains dans la course à la puissance. L’époque de la « mondialisation heureuse » est bien révolue... Le propos ne se limite pas aux (…)
BRETTON WOODS ET LE SOMMET DU MONDE. Jean-Marc Siroën
Juillet 1944 : la conférence historique qui rassembla pendant trois semaines 44 pays fut le moment symbolique du monde à venir d’alors et celui d’un jeu de puissances (big four). Construction d’un Gold Exchange Standard, rôle de l’or, bataille des quotas etc... élaborés sur les principes du roi dollar et de stabilité hégémonique avec une Europe en déclin, en particulier pour le Royaume-Uni. Jean Marc Siroën (1) nous plonge dans cette période d’un nouvel ordre mondial en gestation avec une double lecture : celle des faits saillants mais surtout à travers quelques brillants portraits de personnages (White, Keynes...), qui ont marqué de leur nom ce moment de basculement historique. Ainsi le roi dollar est consacré contre le bancor (un privilège exorbitant !), au risque de (…)
LES ENJEUX DE SÉCURITE DE L’INDE EN ASIE DU SUD. Olivier DA LAGE
L’Inde, rivale en retrait de l’emprise chinoise, acquiert désormais certains attributs de la puissance (1ère population mondiale, 5ème rang pour le PIB). Pour analyser son émergence, Olivier Da Lage (1) plonge dans les racines historiques profondes (théorie de La Mandala, non-alignement, autonomie stratégique et découplage...) qui permettent d’éclairer encore sa géopolitique contemporaine. Mais l’auteur déconstruit largement les faux semblants et les contradictions d’une Inde parfois hésitante (et/ou soucieuse) sur ses choix internationaux. Il démêle de façon passionnante les ambiguïtés et les difficultés du pays à se placer en équilibre entre l’Occident, la Russie et la Chine. Si cette dernière est le grand défi, il s’agit aussi de maintenir cette doctrine dans un environnement (…)
LA CULTURE COMME ENJEU SÉCURITAIRE. Barthélémy COURMONT
Vous lirez ci-dessous un texte de recherche d’une grande originalité. Barthélémy Courmont (1) introduit un champ peu connu : le patrimoine est devenu un sujet géopolitique et sécuritaire à part entière. Si cette dimension n’est pas récente en soi, elle prend une résonance nouvelle, notamment dans l’opinion publique et sa prise en charge par les politiques. Avec de multiples exemples et une dimension historique, l’auteur pose la question des « frontières » : entre l’émotion et la raison, entre les dimensions civilisationnelle et universelle... L’approche est transdisciplinaire. Dans le contexte d’aujourd’hui se dessinent en contrepoint les enjeux de guerre hybride, les logiques de puissance et de pouvoir, de cohésion identitaire, au coeur des stratégies et tactiques à l’oeuvre dans (…)
QUELLES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION POUR LES PETITS ETATS EN RELATIONS INTERNATIONALES ? LE CAS DU QATAR. Par Lama FAKIH
Dans cet article, l’auteure (1) analyse la construction de la puissance, « souvent oubliée dans un monde pacifié par l’économie ». La recherche de puissance - ici appliquée en particulier au Quatar - passe par de multiples ressources mais aussi par une volonté qui prenne en compte plusieurs éléments stratégiques (citons le hedging et la diplomatie de niches). Cette étude appuyée sur plusieurs faits historiques, permettra aux lecteurs de comprendre les nombreuses contradictions apparentes dans les positions des Etats et singulièrement celles des plus petits. Un texte essentiel dans le monde actuel où l’idée de puissance revient de façon brutale. Mais celle-ci n’est jamais une garantie de réussite et surtout de permanence. Madame Fakih démontre aussi l’insondable fragilité d’une (…)
LES ENJEUX STRATÉGIQUES DES CÂBLES SOUS-MARINS DE FIBRE OPTIQUE DANS L’ARCTIQUE. Par Michael DELAUNAY
L’histoire des câbles sous-marins a plus de 170 ans et est bien documentée. Pourtant, l’extraordinaire réseau océanique et maritime, littéralement démultiplié par les performances de la fibre optique, est bien moins connu en France. Raison de plus pour lire l’étude précise de Michael Delaunay (1) qui propose un fort utile état des lieux, en traitant de cet espace quasi vierge qu’est le bassin arctique. L’auteur en profite pour mettre en relief les aléas, notamment financiers, qui pèsent sur les réalisations et les projets dans ce domaine, tout en fournissant de nombreux et indispensables liens informatiques. Car, il s’agit potentiellement d’un « Grand jeu » (les États y sont des acteurs essentiels, à commencer par la Russie), les pratiques de partenariat, de compétition et de (…)
L’ARCTIQUE ET LA GUERRE D’UKRAINE. Par Thierry GARCIN
La compétition des puissances s’inscrit aussi dans « les marges ». La guerre lancée en Ukraine par la Russie touche particulièrement l’Arctique (le continent blanc). Créé en 1996, le Conseil arctique dédié à la recherche scientifique et aux populations autochtones, connaît désormais un basculement géopolitique brutal. Dans cet article précis et contextué, Thierry Garcin (1) nous livre les multiples enjeux géographiques et institutionnels. Problématique des frontières de la pêche maritime (ex : entre la Norvège et la Russie), compétition pour les ressources naturelles, statut juridique des routes du Nord, avenir des sites gaziers de haute latitude, accords et bases militaires... On l’a compris, l’auteur fournit une analyse en partie prospective sur la remise en cause des traités (…)
LA REVANCHE DE LA (GEO)POLITIQUE SUR L’ECONOMIQUE
Le temps n’était-il devenu qu’économique ? Y-a-t-il un bon usage de la mondialisation ? Dans quels domaines est-il déterminant de limiter les effets des forces du marché ? Comment analyser et réduire les relations inégales entre les acteurs internationaux ? Allons nous vers une économie de guerre ? Peut-on appliquer le modèle de la rationalité des marchés à la géopolitique ? Le temps présent bouscule les certitudes et réactualise le rôle de l’action politique.
L’article s’interroge sur le basculement entre le primat économique et la réalité (géo) politique, pourtant intimement liés. Un basculement peut-être accentué par un futur embargo sur l’énergie. Le retour de la « visibilité guerrière » et du réalisme dans les relations internationales est brutal.
La reprise du « business as (…)
UKRAINE. CRISE, RETOUR HISTORIQUE ET SOLUTION ACTUELLE : « LA NEUTRALISATION ». Par David CUMIN
Dans cet article, David Cumin (1) utilise le temps long pour analyser la succession des crises entre la Russie et l’Occident depuis 1998 ainsi que l’évolution institutionnelle. Les forces centrifuges et centripètes toujours à l’oeuvre, contribuent à la désagrégation de l’espace post-soviétique. « Le grand dessein de Poutine est l’Union eurasienne », le maintien ou le rétablissement d’une hégémonie panrusse. A partir d’une analogie avec l’Autriche à la fin de la guerre, l’auteur ébauche une solution intermédiaire pour l’Ukraine : une neutralisation « géopolitique » - un non alignement - (un deal entre les puissances) qui permettraient de favoriser la stabilité régionale. Une approche qui toutefois ne garantit ni la souveraineté de l’Ukraine, ni la pacification dans un moment historique (…)
VLADIMIR POUTINE : LA FIN D’UN RÈGNE ? Par Galia ACKERMAN
Galia Ackerman (1) fait une lecture sans concession - mais avec une grande précision factuelle et analytique - de la politique intérieure et extérieure russe, dans sa gestion de l’espace post-soviétique. S’appuyant sur de nombreux exemples, sous forme d’un bilan, elle « lève le voile » en prenant la mesure des échecs (ou des faibles succès provisoires), en Syrie, en Lybie, dans les relations incertaines avec la Turquie, dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, au Belarus et au Donbass. L’affaiblissement intérieur du régime poutinien est également notable : chute de la rente pétrolière et gazière (depuis 2014), impact majeur de la crise sanitaire, sanctions internationales et perte de confiance d’une partie de la population. Le pouvoir russe a du mal à tirer des avantages (…)
 « LA RUSE ET LA FORCE AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES »
« LA RUSE ET LA FORCE AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES »
Tristan et Yseult : « Démesure n’est pas prouesse ». Une phrase à la résonance forte dans le contexte géopolitique actuel. On lira les analyses de Jean Vincent Holeindre (1) avec le regard décalé et large du philosophe, qui lie les dimensions militaire, politique et sociétale de la guerre. L’extension du domaine de la lutte, de la guerre, la privatisation de certains outils, s’incarnent dans de nombreux exemples. Dans la compétition actuelle des puissances, la stratégie historique des démocraties les fragilisent au niveau interne et externe. La question des valeurs est posée, dans un monde où les puissances autoritaires affichent (au moins en apparence) plus de cohésion. On lira l’interview de J.V. Holeindre « en miroir » avec celle de Bertrand Badie . Des positions en partie (…)
 L’INTER-SOCIALITE AU COEUR DES DYNAMIQUES ACTUELLES DES RELATIONS INTERNATIONALES
L’INTER-SOCIALITE AU COEUR DES DYNAMIQUES ACTUELLES DES RELATIONS INTERNATIONALES
Avec des ouvrages majeurs, le professeur Bertrand Badie tient une place particulière dans la recherche sur les relations internationales. « Fin des territoires (1995), Impuissance de la puissance (2004), Le temps des humiliés (2014) » etc... L’auteur déconstruit les objets traditionnels de la géopolitique, en particulier (néo) réaliste, dont les piliers convenus ne sont plus performants. « L’ordre réaliste se veut exclusivement politique, fait d’équilibres militaires, de polarité et d’alliances.... ». L’on voit bien aujourd’hui, qu’il n’y a plus de polarisation, ni de puissance qui puissent organiser l’ordre international. Les alliances sont désormais instables. B. Badie retrouve ainsi depuis plusieurs ouvrages l’approche du grand sociologue Emile Durkheim - structures évolutives mais (…)
LES MIRAGES SÉCURITAIRES. Par Bertrand BADIE
L’éditorial de Bertrand Badie (1) s’inscrit dans deux directions originales peu appuyées ailleurs : épuisement de la perte d’efficience de la puissance et montée des paramètres sociaux dans le système mondial. « Paradoxalement », dans un monde post-bipolaire, la grande stratégie reste celle des Etats-nations, y compris pour les puissances émergentes. Il en découle une crise de la gouvernance, car les dynamiques actuelles ne peuvent être appréhendées dans une simple logique nationale. Les urgences climatiques, sanitaires, alimentaires... doivent être gérées selon une approche de sécurité globale, en passant de la puissance mondiale à celle de puissances mondialisées, enfin en accord avec les enjeux de la mondialisation contemporaine. La thèse est particulièrement stimulante dans un (…)
 LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ. Par Thierry GARCIN
LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ. Par Thierry GARCIN
« Le territoire est indémodable. » Sans remettre en cause la connectivité immatérielle croissante de notre monde, Thierry Garcin (1), à partir d’exemples significatifs, analyse le marquage du « territoire », qu’il soit terrestre ou maritime. La Terre reste « bornée » : espaces maritimes convoités, territoires occupés, querelles frontalières, conflits gelés... Ces facteurs classiques de la puissance sont réactualisés par le progrès scientifique et technique. Une lecture bienvenue dans le chaos actuel, qui nous ramène aux fondamentaux et pose en contrepoint la question de la nature humaine.
(1) Chercheur associé à l’université de Paris. Auteur de : « La Fragmentation du monde. La puissance dans les relations internationales ». Economica, 2018.
LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ
Si les (…)
UNION EUROPÉENNE : UNE SOLIDARITÉ TOURNÉE VERS UN PROJET DE PUISSANCE ? Par Joséphine STARON
Depuis les premiers instants de la construction européenne (CECA, CEE, U.E), l’on connaît le conflit des interprétations autour de ses finalités et de ses modes d’organisation. Joséphine Staron (1), dans le contexte de la crise des institutions multilatérales, met en perspective les questions de sens qui déterminent l’ambiguïté de la dynamique d’intégration : « logique de l’engrenage » (Jean Monnet et le « spill over »), mais une solidarité souvent tardive (affaire des sous-marins, crise migratoire, crise sanitaire, position vis à vis de la Turquie...). Si l’expérience d’une construction par « consentement » a permis d’exorciser l’histoire dramatique du continent, l’éventuel découplage stratégique avec les Etats-Unis, constitue un nouveau défi historique. On peut s’en réjouir ou le (…)
LES TALIBANS DANS LA STRATÉGIE DIPLOMATIQUE DE LA CHINE. Par Yohan BRIANT
Dans cet article, le jeune chercheur Yohan Briant (1) nous livre avec clarté et précision, une analyse stratégique de la diplomatie chinoise vis à vis des Talibans. La compréhension des enjeux du long terme permet de dépasser la lecture immédiate des évènements. On lira avec intérêt un rappel historique bienvenu de la position chinoise dans le système international : « émergence pacifique » (avec le primat de l’économique) puis développement d’un récit et discours, d’un modèle alternatif à celui de l’Occident. On parle parfois du Consensus de Pékin qui privilégie les échanges économiques, les activités structurantes pour les pays du Sud etc... avec un Etat fort sans préoccupation politique pour la question des Droits de l’Homme. Aujourd’hui la sécurisation des zones frontalières est un (…)
🔎 CHINE/ETATS-UNIS/TAÏWAN : LE TRIANGLE INFERNAL. Par P.A. Donnet
Dans cet article, P. A. Donnet (1) analyse la multidimensionnalité de la conflictualité dans la Mer de Chine, avec des enjeux systémiques tels le devenir de Taïwan, la dimension régionale de la puissance, les nouvelles relations Chine/Russie/Japon. Bien au delà de la question économique, l’auteur détaille les forces militaires en présence. La question posée de la souveraineté de Taïwan nous ramène désormais à celle de puissance. Tous les ingrédients d’un avenir incertain pour l’équilibre mondial sont réunis. On retrouve de façon intuitive l’analyse de Raymond Aron pour qui « l’état de nature » du système international, est du à l’absence d’une instance qui détienne le monopole de la violence légitime en assurant le pouvoir central. Dans ce triangle stratégique (avec en contrepoint le (…)
LA RIVALITÉ CHINE/ÉTATS-UNIS SE JOUE ÉGALEMENT DANS LE SECTEUR DE LA HIGH TECH. Par Estelle PRIN
Loin est déjà le temps de la simple imitation et du rattrapage « passif »... L’Asie et plus particulièrement la Chine sont passées en quelques décennies « du riz à la puce et au vide (immatériel) »... Au cœur de cette formidable dynamique : la question des semi-conducteurs analysée par Estelle Prin à travers de multiples exemples-clefs (1). A partir d’un rapide rappel historique du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine (avec de multiples exemples), l’auteure analyse la dimension économique de la révolution digitale. La Chine, désormais sur la frontière technologique, tente de faire jeu égal et même dépasser les grandes puissances historiques... Les enjeux : course à la puissance y compris militaire, relations entre l’Etat central, les entreprises et la politique, (…)
🔎 LES « MÉTAUX RARES » N’EXISTENT PAS... Par Didier JULIENNE
Dans cet article très stimulant, Didier Julienne (1) se livre, avec de multiples exemples, à une véritable déconstruction de l’infox sur les « métaux et terres rares ». Une infox, qui tout en développant une mythologie guerrière, interdit la construction et le renouvellement d’une doctrine des ressources naturelles pour les pays consommateurs et producteurs. Dans le contexte géopolitique et environnemental que l’on connaît, l’Intelligence Economique est essentielle, non seulement pour dévoiler les logiques de puissance, mais aussi et surtout pour favoriser les transitions vers un modèle électrique, en dépassant les lectures purement populistes des enjeux. Faire appel aux « lois naturelles » de la rareté, a conduit à l’abandon de la souveraineté dans nos doctrines minières. Une (…)
🔎 L’ARCTIQUE DANS LE SYSTÈME INTERNATIONAL. Par Thierry GARCIN
« Nous sommes dans un milieu exceptionnel, où la souveraineté sur les territoires prime. » Thierry Garcin (1) nous propose un texte stimulant sur la dimension géopolitique de l’Arctique aux multiples enjeux : climatique, militaire, maritime, ressources essentielles mais aussi lieu exceptionnel de coopération scientifique. L’Arctique, « sans traité » est l’espace d’un jeu de puissances et de nations qui ne sont pas reléguées aux objets perdus de l’histoire... Elle offre une visibilité « d’équations classiques de la puissance », par opposition à la « confortable mais anglo-saxonne notion de gouvernance ». Cette région singulière : peut-être un « reflet » du reste du monde dans ses espoirs et ses inquiétudes, en particulier pour le nord de l’Europe ?
(1) Thierry Garcin est Docteur (…)
LES PARAMÈTRES DE LA STRATÉGIE DE DÉFENSE DE L’IRAN. Par Tewfik HAMEL
On lira avec grand intérêt l’article de Tewfik HAMEL (1), au moment où Vienne accueille ces jours-ci pour la seconde fois, des discussions sur le nucléaire iranien, à la suite de la décision de Joe Biden de revenir dans la négociation (cf accord de juillet 2015). L’auteur analyse avec précision les grandes difficultés historiques qui rendent incertaines toute négociation : humiliations réciproques, sanctions et représailles, cf attaque récente du site nucléaire de Natanz (11 avril, 0121), enrichissement à 60 % de son uranium en réponse, forces extérieures mais aussi intérieures, etc... Ce qui est en question, c’est le rôle de puissance régionale de l’Iran. Le champ d’analyse est large pour évaluer l’équilibre politico-stratégique et militaire du Moyen Orient de demain. S’il est (…)
🔎 LES NOUVELLES GUERRES SYSTEMIQUES NON MILITAIRES. Par Raphaël CHAUVANCY
La « compétition » s’est retournée contre ses promoteurs (occidentaux), elle est désormais globale. C’est une phase systémique qui implique tous les domaines de la matière ou de la connaissance. Dans cet article, Raphaël Chauvancy (1) vous propose toute une réflexion sur la puissance, qui nous conduit à décrypter ce que l’on appelle désormais la guerre économique, mais surtout la guerre cognitive. Elles se mènent largement de manière couverte. « Leur trame véritable est constituée de prédations cognitives, de raids financiers, de politiques d’encerclement économique ou de pièges normatifs ». L’auteur propose également une analyse par grand pays, et au delà, un retour sur la faiblesse de la démocratie qui est d’abord « un exercice ».... . La Chine par exemple, a parfaitement réussi la (…)
L’INTERNATIONALISME MÉDICAL CUBAIN AU-DELÀ DE L’ACTION HUMANITAIRE. Par G. B. KAMGUEM
Dans cet article, Gervis Briand KAMGUEM (1) propose une lecture pondérée d’une dimension souvent peu connue du Soft Power : l’internationalisme médical, en l’occurrence celui de Cuba. Après un rappel historique bienvenu sur l’isolement de l’île de Cuba et de son régime, sont abordées les multiples participations des médecins cubains lors de catastrophes humanitaires et sanitaires. On lira avec intérêt, les réussites, les éloges et critiques, ainsi que les ambiguïtés de ce modèle singulier de coopération, toutefois essentiel dans la construction d’une influence géopolitique majeure, pour limiter l’isolement et développer un réseau diplomatique.
(1) Chercheur affilié à la Geneva Institute of International Relations (GIIR). Analyste pour les programmes d’urgence et de rétablissement à (…)
LE SECTEUR BANCAIRE, AU CŒUR DU MODELE ECONOMIQUE CHINOIS, SEVEREMENT REPRIS EN MAIN. Par Jean François DUFOUR
On lira avec grand intérêt l’article très documenté de J.F. Dufour (1), sur la reprise en main majeure du secteur bancaire chinois, qui intervient également dans le secteur des BATX. Si la question du risque financier est bien sûr officiellement posée, la disgrâce de certains dirigeants, s’apparente d’abord à un retour du primat du politique sur celui de l’économique. Les dirigeants chinois entendent rester à la manoeuvre face des groupes désormais très puissants, et surtout privilégier la stratégie plutôt que la rentabilité du court terme. L’économie chinoise demeure étatisée. Les enjeux géopolitiques, les objectifs du « Made in China » 2025 priment sur tout le reste. Continuer le « business as usual » semble de plus en plus difficile. Peut-être une leçon de pragmatisme politique, (…)
UNE EUROPE TRIPLEMENT ORPHELINE
Orpheline de son lien privilégié avec les Etats-Unis, de ses alliances militaires historiques (l’Otan est en état de « mort cérébrale », E. Macron), orpheline des valeurs communes avec la plus grande démocratie du monde (« Nous avons perdu notre route » J. E. Stiglitz).
Géopolitique des masques et mise au pas de Hong Kong, diplomatie gazière de la Russie (North Stream2), lois extraterritoriales américaines... Les politiques de puissance et leurs enjeux sont aussi aux marges des frontières européennes (Biélorussie, Turquie, Russie, Syrie et Lybie), avec des alliances traditionnelles déconstruites (Etats-Unis). Les défis sont immenses : la Chine est devenue un rival systémique, la Russie est en veille stratégique, les tensions en Méditerranée orientale entre la Grèce et la Turquie (…)
LA DETTE CHINOISE DE DJIBOUTI. Par THIERRY PAIRAULT
Dans cet article, l’auteur (1) nous propose une analyse documentée de la dette et du surendettement de Djibouti, en lien avec la construction du tronçon de la ligne de chemin de fer pour l’Ethiopie. Ce n’est pas uniquement un sujet financier mais une approche géoéconomique et géopolitique. Le lien est fait entre d’un côté une faible rentabilité du projet achevé (approvisionnement aléatoire en électricité, manque de produits à exporter, dégradation conjoncturelle) et bien sûr les enjeux d’influence (droits d’utilisation de la base navale, création d’une clientèle politique de pays, vitrine technologique pour la Chine...), sans exclure les erreurs de gestion... L’Afrique demeure un champ d’expérimentation pour la Chine (« split-diplomacy », diplomatie du « grand écart ») et les pays (…)
U.E - LES DOSSIERS : GAIA-X, 5 G, FONDS EUROPEEN DE DEFENSE, DEEP TECH, CONTROLE DES INVESTISSEMENTS SENSIBLES, POLITIQUES DE SOUVERAINETE...
Les dossiers : Gaia-X, Fonds européen de défense (FED), Deep Tech, question de la 5 G, contrôle des investissements sensibles...
Dans l’article précédent, nous avons vu les circonstances du réveil européen dans le cadre d’un affrontement de puissances avec les Etats-Unis et la Chine. Cette situation a été accentuée par la crise du Covid-19, fonctionnant comme un véritable révélateur de l’extrême fragilité de l’U.E (sur le plan numérique et sanitaire) et de son « soft power ». Les Nouvelles Routes de la Soie (Belt and Road initiative) sont aussi perçues, un peu comme un cheval de Troie. On se rappelle que la Commission s’est souvent érigée contre la construction de champions européens : citons le cas emblématique, Alstom/Siemens .
Toutefois, dés avant la crise sanitaire, Ursula von (…)
CONSEIL DE SECURITE - L’AFRIQUE EST-ELLE PRÊTE POUR PLUS DE RESPONSABILITÉ ?
Gervis Briand KAMGUEM (1) propose dans cet article, une réflexion sur la place de l’Afrique dans le monde et singulièrement sur son absence (quasi totale) dans la gouvernance mondiale. L’auteur met en perspective historique les fondements de la création du Conseil de sécurité des Nations-Unies et le contexte géopolitique actuel. Il envisage les forces et faiblesses des pays africains en confrontation avec leur désir légitime à assumer une responsabilité principale sur les questions de paix et de sécurité. Une gouvernance mondiale bien mal en point, qu’il reste profondément à rénover.
(1) Diplômé de l’Institut de Relations Internationales et Stratégique de Paris et de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Il prépare une thèse de doctorat sur les enjeux de la gouvernance mondiale (…)
BERTRAND BADIE : « LE MULTILATERALISME EST BLOQUE PAR LES ETATS ET LE NEO-NATIONALISME MAIS FONCTIONNELLEMENT INEVITABLE… »
L’interview de Bertrand Badie (1),(2) vous propose la mise en perspective d’une lecture longue dans le cadre de ruptures contextuelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19 et bien avant. L’auteur évoque un retour « inévitablement à l’interventionnisme étatique, le néo-libéralisme n’est plus opérationnel », alors même que le multilatéralisme est simplement bloqué par les Etats et le néonationalisme, mais fonctionnellement inévitable…« . On retrouvera toujours avec plaisir les analyses de B. Badie, qui tout au long de ses projets de recherche, rentrent dans de grands sujets : « le territoire c’est fini », « fin de la bipolarité », « la puissance est un concept désuet (à distinguer de l’ hégémonie), « la peur est de façon récurrente un facteur de l’histoire » .... . Il y a dans (…)
COMMENT LA CHINE SE PREPARE POUR FAIRE FACE AU DEUXIEME CHOC ECONOMIQUE POST-COVID. Par J.F. DUFOUR
Dans ce texte qui intervient au coeur des conséquences de la pandémie pour la Chine, Jean-François Dufour (1) nous invite à envisager un choc de demande pour ce pays en raison de l’amoindrissement des commandes des clients étrangers. Les mesures prises s’inscrivent dans un fort climat d’incertitude sanitaire et économique. En contrepoint de l’analyse conjoncturelle, J.F. Dufour revient sur les tournants structurels et politiques du programme des autorités chinoises. Le Made in China 2025 devrait en sortir renforcé, car il permet de « marcher sur ses deux jambes » : soutien économique et bancaire pour les entreprises stratégiques et bien sûr affirmation de la mainmise étatique. Hier comme aujourd’hui, nous sommes bien loin des principes de concurrence libre et non faussée ! Pékin met « (…)
GUERRE ECONOMIQUE. ELEMENTS DE PRISE DE CONSCIENCE D’UNE PENSEE AUTONOME. Par Christian HARBULOT
PRESENTATION
Christian Harbulot (1) vous propose dans le texte ci-dessous une approche essentiellement cognitive sur certains concepts, et in fine sur les questions de puissance et de guerre économique. Le mot guerre économique est bien sûr polysémique et interpelle presque tout le champ de la connaissance, en particulier le spectre large de la géopolitique, de l’histoire, de la géoéconomie, de la philosophie politique... et nombre de lectures analytiques de GeopoWeb ! L’auteur ne revient pas dans ce texte sur le débat autour de ce vocabulaire encore discuté. Si nous utilisons de façon simple, les notions d’imposition et de prédation, on met à jour le poids normatif du vocabulaire (la fabrique du consentement) et « l’aspiration » des ressources (en particulier métaux rares et (…)
LA CRISE DU COVID-19, UN REVELATEUR DE LA NATURE PROFONDE DE L’UNION EUROPEENNE. Par Michel FAUQUIER
Michel Fauquier (1) vous propose dans cet article un travail d’orfèvre, avec des références historiques récentes, qui mettent bien en perspective l’inaction des autorités de l’U.E dans ce moment particulièrement difficile face à la crise du Covid-19. Tout au plus sont envisagées quelques mesures économiques (long désaccord !). Finalement, le 9 avril, un plan de soutien économique de 540 milliards d’euros est décidé (2),(3). Ce constat désolant traduit la nature profonde de l’Union européenne. Cette dernière non seulement tarde dans ses réactions (n’est pas proactive, comme disent les spécialistes...) mais n’est plus aujourd’hui capable de dresser les bonnes priorités, si ce n’est économiques (et encore). Comment s’étonner ensuite du « désamour » des populations, du « retour des Etats (…)
(1) GEOPOLITIQUE D’INTERNET et du WEB. GUERRE et PAIX dans le VILLAGE PLANETAIRE. Par Laurent GAYARD
Dans cette très belle recherche, Laurent Gayard (1) se propose d’interroger la capacité des Etats à contrôler ou s’approprier les différentes composantes logicielles, logiques et physiques du réseau ou au contraire à échouer à le faire. Il mène une réflexion profonde sur un Internet « fragmenté » (tentation des internets nationaux, établissements de DNS parallèles, darknets, réseaux alternatifs....). Ecoutons l’auteur : « La géopolitique d’Internet s’exerce dans un espace dual (monde physique des câbles, serveurs, satellites, centres de données)...et le cyberespace (territoire virtuel et transnational). Le maintien de la connectivité physique des infrastructures d’Internet nous renvoie à la géopolitique des mers et des océans ainsi qu’à celle de l’espace, la question de la gouvernance (…)
(2) GEOPOLITIQUE D’INTERNET et du WEB. Souveraineté numérique, enjeu géopolitique, Internet sécessionniste. Par L. GAYARD
DEUXIEME PARTIE - LA SOUVERAINETE NUMERIQUE, ENJEU GEOPOLITIQUE. UN INTERNET SECESSIONNISTE ?
I – La souveraineté numérique, enjeu géopolitique
Si la proposition de réforme chinoise du DNS n’a pas abouti en 2013, cela n’a pas empêché l’Empire du Milieu de se donner les moyens de cadenasser en partie le cyberespace chinois sans pour autant se couper d’Internet. Le « Grand Pare-feu national », ou encore « Grand Firewall » ou « Muraille de Chine virtuelle » sont autant de sobriquets désignant le projet « Bouclier doré », développé par le gouvernement chinois à partir de 1998 et mis en place à partir de 2003. L’arrivée d’Internet en Chine suscitait tout autant l’intérêt que les craintes des instances centrales du Parti Communiste chinois. Il s’agissait donc de créer un outil qui (…)
La GEOPOLITIQUE DES POSSIBLES. Le probable sera-t-il l’après 2008 ?
Réinventer « le plus jamais ça », sinon rien ! (27/03/2020) « L’Europe d’après… » les intentions
La catastrophe humaine des deux guerres mondiales a permis de repousser les frontières de l’horreur (crime contre l’humanité), réconcilier des ennemis irréductibles, construire un droit européen qui dépasse le droit national, favoriser la prospérité au nom du bien être pour le plus grand nombre. Une formule historique, un peu banale dans son expression mais oh combien ambitieuse dans ses objectifs. Ce que l’on pourrait appeler une vision, un projet d’intégration au nom d’un bien commun et des valeurs partagées, une communauté de destins qui a préservé de nombreuses générations de la violence, des bruits de bottes. La crise sanitaire humaine, économique... doit aujourd’hui conduire à (…)
« Une QUADRATURE STRATEGIQUE » au secours des souverainetés nationales
Il est aujourd’hui largement admis que la mondialisation n’est pas ce processus paisible et toujours prometteur, dont on a pourtant longtemps cherché à convaincre les « grincheux ». Ce peut être un formidable accélérateur de puissance pour les uns (pays émergents) mais aussi un réducteur d’hégémonie économique et géopolitique pour les autres (Occident).
En conséquence le débat simple entre les avantages/inconvénients respectifs du libre échange et du protectionnisme (6) (type ouvrage macroéconomique) est peu opératoire dans un monde d’Etats-nation qui font tout pour préserver leur souveraineté sinon leurs emplois. On rentre alors dans une approche stratégique dans laquelle l’émotion ou le désir de puissance priment...
Les vertus annoncées du libre échange total peuvent s’arrêter là (…)
L’Europe commence à réagir à l’EXTRATERRITORIALITE du droit américain. Enfin ! Par Stephane LAUER
L’Europe commence à réagir à l’extraterritorialité du droit américain. Enfin !
Stephane Lauer (1), éditorialiste au « Monde », nous éclaire avec une grande clarté et précision, sur l’évolution politique et juridique des lois extraterritoriales américaines... en s’appuyant sur le cas Airbus. « Le droit extraterritorial permet d’appliquer les lois américaines à des personnes ou des entreprises étrangères, pour peu qu’elles aient un lien, même ténu, avec les États-Unis » … . C’est une véritable guerre économique asymétrique (si l’on en doutait !), un bouleversement des catégories traditionnelles, le passage d’un monde ami/ennemi à celui de partenaire/rival, une situation qui pourrait déstabiliser à terme l’alliance géopolitique. Voilà un champ majeur dans lequel l’U.E doit encore (…)
LA DEFENSE FRANCAISE, HERITAGE ET PERPECTIVE EUROPEENNE. Intervention du Général J. PELLISTRANDI
JERÔME PELLISTRANDI, Général 2S de l’armée française, historien et rédacteur en chef de la Revue de Défense Nationale évoque la question de la Défense française dans les années à venir, et la corrélation de cette dernière avec une perspective européenne comme le souhaite tant Emmanuel Macron Compte rendu de la conférence : « La défense française en 2020, entre héritage et perspective européenne » (14/01/2020)
Avant de parler de perspective, il convenait de faire un bref état des lieux. Monsieur Pellistrandi a déjà commencé par rappeler le caractère historiquement prépondérant de la défense dans le modèle français. En France comme ailleurs on ne peut faire abstraction de l’Histoire pour comprendre le caractère militaire d’un pays : preuve en est jusqu’au Président Mac Mahon, le (…)
PARADIS FISCAUX. « Il faut changer la façon dont on impose les profits des sociétés multinationales ». G. Zucman
PARADIS FISCAUX. « Il faut changer la façon dont on impose les profits des sociétés multinationales ». G. Zucman
Suite à nos échanges, Gabriel Zucman nous a donné l’autorisation d’inscrire l’adresse de son site (cf ci-dessous) sur lequel l’auteur publie des textes en anglais et en français, notamment plusieurs tribunes.
http://gabriel-zucman.eu/policy-debates/
A lire : A lire les extraits publiés dans le Monde (6 février 2020) de l’ouvrage de Gabriel Zucman et Emmanuel Saez : « Le Triomphe de l’injustice », qui sortira le 13 février 2020 au Seuil « Rien n’empêche les Etats de taxer les grandes fortunes d’aujourd’hui » (…)
L’EUROPE FACE AUX DEFIS DE LA MONDIALISATION (Conférence B. Badie)
L’Europe face aux défis de la Mondialisation Jeudi 7 mars 2019
Conférence de Bertrand Badie, professeur des Universités à l’Institut d’études politiques de Paris et enseignant-chercheur au CERI
Présentation
Monsieur Badie tout au long de ses projets, rentre dans de grands sujets. « Le territoire c’est fini », « Fin de la bipolarité », « l’impuissance de la puissance ». Il y a aussi tout un vocabulaire qui lui est spécifique. « La puissance n’est plus ce qu’elle était ». Pourtant Bertrand Badie n’aime pas certains termes : géopolitique, austérité, chaos mondial … « Le chaos c’est la formule que l’on emploie quand on ne comprend pas et quand on ne comprend pas, c’est qu’on ne veut pas comprendre... ». B. Badie parle d’un monde apolaire et non chaotique. L’approche de (…)
De la COMPETITION ECONOMIQUE à la GUERRE FROIDE TECHNOLOGIQUE
De la compétition économique à la guerre froide technologique
Un faisceau de facteurs qui dévoile une nouvelle guerre technologique
Après la compétition, la guerre économique, après la frontière technologique, le front technologique... La compétition économique - une bataille simplement entre entreprises et compétences respectives- sorte de fin économique de l’histoire et alternative douce à la guerre traditionnelle, s’est pathétiquement élargie à une nouvelle bataille entre nations. D’aucuns évoquent une nouvelle guerre froide attisée par les enjeux de puissance et les questions de sécurité nationale. Un moment où, d’une certaine manière les pays occidentaux se réveillent avec la gueule de bois... Hier ne parlait-on pas encore de la distance à la frontière technologique pour les (…)
Le traité d’Aix-la-Chapelle
Le Traité d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 par Emmanuel Macron et Angela Merkel au nom de leurs pays respectifs est un traité de coopération bilatérale qui vient compléter les dispositions du Traité de l’Elysée de 1963. Ce traité précise les modalités de la coopération entre la France et l’Allemagne et cible certains domaines précis dans lesquels elle sera renforcée. Avant de parler du traité lui-même et de détailler le contenu, la discussion politique en amont de la signature doit être thématisée, parce qu’elle est symptomatique du climat actuel ainsi que de la difficulté du multilatéralisme. Le Traité d’Aix-la-Chapelle était, certes, disponible sur Internet au moins une semaine avant la signature, mais soit les sources étaient par trop confidentielles, soit on a feint de (…)
ACTUALITES SUR L’OR NOIR. Par Francis PERRIN
Actualités sur l’or noir
Francis Perrin a travaillé pendant plusieurs années comme journaliste et consultant indépendant sur l’énergie et les matières premières. Il est chercheur associé à l’OCP Policy Center (Rabat) et directeur de recherche à l’IRIS (Paris) sur les problématiques de matières premières. Il donne des cours à l’Université de Grenoble Alpes et à Lyon III. Il rédige les chapitres sur le pétrole et les produits pétroliers dans le rapport annuel Cyclope sur les matières premières (Editions Economica).
- Les Etats-Unis, premier producteur mondial de pétrole
Selon l’administration américaine (EIA), les Etats-Unis seraient désormais le premier producteur mondial de pétrole, dépassant ainsi l’Arabie saoudite et la Russie dans ce domaine. On peut se demander si cette (…)
TRUMP REINVENTE LA SOUVERAINETE LIMITEE. Par Pascal Boniface
Pascal Boniface (1), Directeur de l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) remet en perspective dans cet article le rôle des Etats-Unis dans la démarche multilatérale. Cette dernière est toujours relative pour la puissance dominante. Mais avec D. Trump, la question de la pérennité des valeurs communes occidentales est désormais posée, contrairement à l’approche de B. Obama qui s’était engagé dans la construction de méga-zones de libre échange (type TTIP/TAFTA). P.L
(1) Vient de publier « L’atlas des relations internationales » (Armand Colin, 2018) et « La géopolitique illustrée » (Eyrolles, 2018)
TRUMP REINVENTE LA SOUVERAINETE LIMITEE
Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis n’ont jamais été de fervents adeptes du multilatéralisme. Mais, avec (…)
Une mondialisation d’Etats-Nations en tension
........ au delà de la fragmentation des processus productifs Source : P. Lallemant 018
Multipolarité asymétrique, pivot et « leading from behind » (Obama) puis unilatéralisme (Trump) Période NTICPériode SUBPRIMES
Mondialisation heureuse (années 90) Paix et « doux commerce » UnipolaritéMondialisation froide (années 00…) Guerre économiques, logiques de puissance. Apolarité
Deux doctrines Consensus de WashingtonConsensus de Pékin
Capitalisme anglo-saxon stratègeCapitalisme d’Etat développeur
Surveillance des investissements étrangers (Exxon-Florio). Fonds de pension, rente géostratégique. Sécurisation des flux (pétrole, gaz), cordons stratégiques. Politique de containment (Cocom...)Hier et aujourd’hui : Fonds souverains, Gazprom, Pétrobras….
Politique prédatrice, (…)
LES THEORIES DES RELATIONS INTERNATIONALES AUJOURD’HUI. Par D. Battistella
Dario Battistella (1), Professeur de Science Politique à Sciences Po Bordeaux, vous propose dans cet article de faire le point sur les théories des relations internationales : des origines tardives dans la pensée politique à l’état des lieux contemporain (entre internationalistes idéalistes, réalistes « triomphants » et approches contestataires...). Patrick Lallemant
(1) Auteur notamment de ‘Théories des R.I’, Presses de Sciences Po, 2015, 5e édition. Vous êtes également invités à visiter le site de l’auteur https://dariobattistella.fr/
Les théories des relations internationales aujourd’hui
Définies comme l’ensemble des relations qu’entretiennent les acteurs sociaux au-delà des limites de leurs unités collectives d’appartenance considérées individuellement, les relations (…)
Guillaume Duval et Henrik Uterwedde, « Traité de l’Elysée 2.0 : Les clés d’une nouvelle étape de l’intégration européenne ? » (6 février 2018)
A l’occasion du 55ème anniversaire du traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 entre la France et l’Allemagne, le Lycée du Parc a eu l’honneur d’accueillir deux intervenants, Guillaume Duval et Henrik Uterwedde.
Cette conférence est le fruit d´une coopération entre le lycée du Parc et l´office franco-allemand pour la jeunesse (ofaj). Sans l´aide substantielle de cette institution, créée dans le cadre du traité de l´Elysée de 1963 et qui a rapproché les deux pays grâce aux innombrables échanges, cette conférence n´aurait pas vu le jour.
D’une part, M. Duval, éditorialiste et rédacteur en chef du magazine Alternatives Économiques, et auteur de La France ne sera plus jamais une grande puissance ? Tant mieux ! et de Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes. Il (…)
MONDIALISATION HEUREUSE, FROIDE et JEU DE MASQUES...
MONDIALISATION ET PERENNITE DES ETATS-NATIONS Source : P. Lallemant, juin 2017
L’on savait depuis longtemps qu’il existait des cycles économiques et des cycles d’affaires (business cycles). Les trois dernières décennies l’ont souvent rappelé de façon dramatique (crise de « la nouvelle économie » fin des années 90, crise des subprimes à partir de 2007). Peut on penser que le mouvement des idées dominantes suit ou précède ces cycles réels ?
Au début des années 80, on se souvient de la fameuse phrase attribuée à R. Reagan :« la solution au problème n’est pas l’Etat, le problème c’est l’Etat ». La grande décennie 90 symbolise la victoire absolue du marché devenu un « level playing field » dans le cadre de la révolution technologique des NTIC. L’idée de gouvernance mondiale prime (…)
RESISTANCE DES ETATS, TRANSLATION DE LA PUISSANCE
Resistance des Etats, translation de la puissance
La puissance a horreur du vide. « Que la décennie 90 était belle ». Les territoires étaient remplacés par des communications virtualisées. L’opposition idéal-typique entre géopolitique et géo-économie semblait finalement réconfortante, les conflits territoriaux dépassés par la modernité de l’échange marchand... La dérèglementation économique et financière n’a finalement pas favorisé la réglementation internationale par les normes et les valeurs (crise de l’OMC et du multilatéralisme).
Ce qui était « rassurant » dans le monde d’après-guerre (bipolaire avec équilibre de la terreur), c’était sa (relative) rationalité et prévisibilité. Ce qui était illusoire dans le monde d’hier (décennie 90), c’était le bonheur par le marché mondial (…)
Libéraux contre libéraux
L’occasion était trop belle pour refonder le couple franco-allemand après deux élections, les présidentielles en France et les législatives en Allemagne, qui ont donné une large victoire aux forces pro-européennes de part et d’autre du Rhin. Ici, un président Macron qui entame un tournant libéral, de l’autre côté, un parti libéral (FDP) qui double son score par rapport à 2013, même si la montée du parti d’extrême-droite AfD ternit quelque peu l’image d’une Allemagne résolument tournée vers une consolidation de l’Union européenne. Or, on a pu constater dès le 24 septembre, le soir des élections allemandes, que les principaux adversaires de M. Macron sont justement ces libéraux du FDP qui n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur celui qui avait proposé la création d’un budget (…)
Ami - Ennemi : Une dialectique franco-allemande ?
En dépit d’une relation désormais présentée comme séculaire, l’amitié franco-allemande, plus que jamais, est une relation qui pose et fait question entre la France et l’Allemagne. Au cours de ces dernières années, elle a ainsi été au cœur des débats concernant le projet politique qui devait guider l’Union Européenne. Le controversé Traité Constitutionnel fut une initiative du « couple » franco-allemand en 2002 avant d’être soumis au vote des Parlements ou par référendum dans les pays membres en 2005, et le tandem franco-allemand eut un rôle majeur dans les soubresauts de la crise financière et de la dette européenne. Dans un cas comme dans l’autre, l’impératif de l’amitié a servi de cadre de référence pour mener une action politique commune, donnant à ce rapport interindividuel une (…)
PUISSANCES MOYENNES d’hier et d’aujourd’hui entre impuissance et émergence (B. Badie, professeur des Universités, Sc Po Paris)
CONFERENCE DE BERTRAND BADIE SUR LES NOUVELLES PUISSANCES MOYENNES. Sources d’instabilité, entre impuissances et émergences, 15 mai 2017
Compte rendu par J.L Ferrandery, professeur d’histoire-géographie et géopolitique (et Operto Chiara)
La puissance moyenne est très peu conceptualisée et très utile dans la connaissance du système international. D’où vient cette idée de puissance moyenne ? Comment la saisir ? Et comment en tirer du « jus explicatif » ? C’est ce que nous verrons dans un premier temps.
Dans un deuxième temps, nous tenterons de la classer dans l’actuel système international que l’on assimile trop vite à un chaos ; mais il n’y a pas de chaos. Si l’on dit cela, c’est que la grande difficulté en relations internationales est que l’on ne sait pas (…)
DE LA DIT A LA DIPP : LA FRAGMENTATION DE LA...
DE LA DIT A LA DIPP : LA FRAGMENTATION DE LA CHAINE DE VALEUR1. Ou la lecture de deux mondes. P. Lallemant
A quoi sert le commerce international ? Il vise à résorber les indisponibilités relatives ou absolues. C’est au départ une demande de différence2. Si la mondialisation, n’est pas un phénomène nouveau, son changement de degré dans de multiples dimensions (économique, financière, industrielle) produit un changement de nature. La DIT traditionnelle (division internationale du travail) tend à devenir sur le plan productif une DIPP (décomposition internationale des processus productifs). Avec la NDIT (nouvelle division internationale du travail), le Sud émergent accède à la haute valeur ajoutée. Cette mutation historique engage de nouveaux acteurs nationaux, bouleverse le système (…)
Conférence de Pierre-Emmanuel Thomann : La rivalité géopolitique franco-allemande (24 janvier 2017)
Pierre-Emanuel Thomann, (Directeur de Recherches en Géopolitique IERI/ADE, est chercheur à Institut Français de Géopolitique, Université Paris VIII). Il problématise le rapport franco-allemand autour des rapports de force entre les deux pays. Le couple franco-allemand est le fruit de compromis politique entre deux pays rivaux. Une vraie amitié peut-elle alors se construire ?
LA RIVALITÉ GÉOPOLITIQUE FRANCO-ALLEMANDE : OBSTACLE OU SOLUTION À UN PROJET EUROPÉEN EN CRISE ?
M. Thomann s’est exprimé lors de la journée anniversaire franco-allemande, en mémoire du Traité de l’Élysée signé le 22 janvier 1963 entre le Général De Gaulle et le Chancelier Adenauer, scellant une amitié définitive entre les deux pays. Cependant, il demeure toujours des rivalités. Comment expliquer au sein (…)
Conférence d’Henrik Uterwedde : Une monnaie, deux visions (20 janvier 2016)
Présentation
Henrik Uterwedde est chercheur au Deutsch-Französisches Institut (DFI) de Ludwigsburg, Institut consacré aux relations franco-allemandes et à l’amitié franco-allemande depuis 1948, bien avant que cette dernière ne soit scellée par le Traité de l’Elysée en 1963. Le décès d’Helmut Schmidt le 10 novembre 2015 fut l’occasion pour le chercheur de rappeler l’oeuvre politique de l’ancien chancelier, mais aussi à quel point « il faut porter toute son attention aux partenaires européens. Cet altruisme est indispensable ». Cependant, au regard des controverses et des oppositions qui ont animé le « couple franco-allemand » depuis la crise de 2008, qu’en est-il de cet altruisme entre les deux partenaires ?
Conférence
La crise que traverse l’Union Européenne constitue en effet (…)
Conférence de Bertrand Badie : Les fractures moyen-orientales (10 mars 2016)
Présentation
Retrouvez dans ce petit texte quelques unes des problématiques chères à Bertrand Badie
Monsieur Badie, vous êtes un excellent universitaire qui pour autant ne propose pas une pédagogie de la connivence. Avec cet amphi plein, vous noterez que nous ne sommes plus seuls au monde. Tout au long de votre oeuvre, vous poursuivez la quête des pathologies du système des relations internationales. Par votre présence aujourd’hui, nous savons que le sort des humiliés par manque d’intellect nous sera épargné. Notre doute sur votre venue au Lycée du Parc - un seul instant- nous a presque poussé à tomber dans l’impuissance de la puissance de son équipe de CPEC. Ce retournement du monde a failli nous affecter profondément. Le gladiateur de T. Hobbes et le chercheur E. (…)
Conférence de Bertrand Badie - L’énigme des émergents : la Chine rivale ou interdépendante des Etats-Unis ? (21 février 2013)
« Le politique n’est pas que l’art de gérer la confrontation mais aussi l’art de gérer la coexistence »
De nos jours de multiples affabulations à l’encontre de la Chine peuvent être entendues au travers des médias. Ce vent de sinophobie, dont l’équation classique est la peur et l’ignorance, rassure les valeurs occidentales et est l’expression d’un rejet. L’ignorance de cette culture, c’est la peur de voir la Chine s’imposer comme la nouvelle superpuissance. Mais aujourd’hui il devient impossible de raisonner de cette manière.
Les Sciences Politiques adoptent quatre postures différentes au regard de la Chine. L’École réaliste (héritière du « power politics ») pour laquelle il est question d’un monde structuré en termes de puissance. Le gagnant est celui qui accumule les ressources (…)
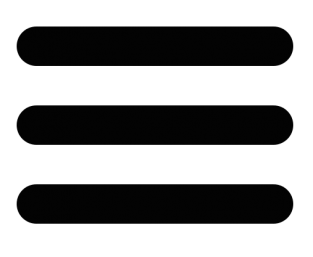

 GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...