HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
LE POUVOIR DE LA MONNAIE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE. ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC JÉZABEL COUPPEY-SOUBEYRAN, PIERRE DELANDRE, AUGUSTIN SERSIRON
« Le pouvoir de la monnaie. Transformons la monnaie pour transformer la société »
vendredi 23 février 2024 COUPPEY-SOUBEYRAN Jézabel, Pierre DELANDRE, Augustin SERSIRON
Les évènements récents (crise financière, crise des finances publiques, rupture des chaînes d’approvisionnement, pandémie, guerre en Ukraine, manifestations de groupes d’agriculteurs…), même si bien sûr ils ne se situent pas tous au même niveau de gravité, viennent percuter les orientations environnementales de l’Union européenne. Ils traduisent au minimum que derrière les chiffres bruts, il y a toujours des hommes et des conditions humaines. Les revenus, les normes environnementales, le modèle agro-industriel avec le poids des acteurs phyto-sanitaires, semenciers, bancaires, centrales d’achats, etc. sont au cœur des revendications des agriculteurs. On retrouve au fond une opposition fondamentale entre compétitivité / rentabilité et nécessités environnementales.
Dans leur essai, « Le pouvoir de la monnaie. Transformons la monnaie pour transformer la société » (Editions Les Liens qui libèrent. 2024), Jézabel Couppey-Soubeyran, Pierre Delandre et Augustin Sersiron nous proposent des outils pour reprendre le contrôle et assurer une véritable bifurcation écologique et sociétale en utilisant le levier monétaire… Une voie innovante qui selon eux pourrait ouvrir une dynamique essentielle. En s’appuyant sur l’histoire de la monnaie, ils montrent la malléabilité de l’institution monétaire et proposent une transformation au niveau du mode d’émission de la monnaie. Mais comment lever les dénis du possible changement monétaire face aux gardiens du statu quo ?
Les auteurs nous préciseront l’articulation avec les autres outils (Pacte vert notamment…) qui peuvent construire un chemin « pour opérer une bifurcation écologique et sociale profonde de notre modèle productif et de nos modes de vie (p. 27) ». Leur approche s’insère dans un monde en basculement et un capitalisme financier en crise avec la question environnementale souvent reléguée à une variable d’ajustement. La contrainte des priorités est parfois avancée comme une limite au changement : réarmement militaire, souveraineté économique, inflation, etc. même si bien sûr tous ces sujets ne sont pas sans lien avec la transition environnementale. Tout est peut-être dans le sous-titre de l’ouvrage : « transformons la monnaie pour transformer la société ». Il s’agit d’un projet de nature institutionnelle exprimé sans bruyante revendication, presque silencieux mais une véritable rupture, un « soft power de la monnaie », une bifurcation monétaire accompagnée d’autres mesures. En réalité surtout, une méthode pour dépasser l’orthodoxie budgétaire européenne en permettant de trouver une solution à ce qui n’en trouve pas aujourd’hui.

Cet entretien n’est pas une simple recension de l’ouvrage cité ci-dessus. Il s’inscrit plus largement dans les défis systémiques pour la France et l’Europe (voire au-delà). La proposition des auteurs peut ouvrir « une dynamique sur des voies multiples » : gouvernance, environnement, inégalités, géopolitique… Un chemin difficile qui tente de combiner technique monétaire, action et nouveau récit pour les citoyens européens quand on considère « la trop lente et inachevée prise de conscience des enjeux contemporains par l’immense majorité des dirigeants.... ». Un chemin difficile on en conviendra, mais légitime et plus essentiel qu’une lecture qui s’accommoderait du statut quo…
ENTRETIEN AVEC J. COUPPEY-SOUBEYRAN, P. DELANDRE et A. SERSIRON
AMPLIFIER LES SOLUTIONS ACTUELLES PAR LE POUVOIR MONÉTAIRE
1. GEOPOWEB. Bonjour et merci pour cet entretien. Votre essai s’inscrit dans l’économie monétaire, des problématiques qui apparaissent souvent comme techniques pour nos contemporains. Avant de rentrer dans le cœur de votre thèse, commençons peut-être par déconstruire certaines solutions alternatives perçues comme non suffisantes pour mettre en œuvre ce que vous appelez une bifurcation environnementale et sociétale. Que pensez-vous tout d’abord du budget de l’UE alloué à la transition (2021/2027), soit un objectif climatique de ses dépenses à hauteur de 30 % ?
En parlant du budget alloué à la transition, vous faites très probablement référence au « Pacte vert pour l’Europe » (le Green Deal). Il s’agit d’un grand plan d’investissements de quelques 850 milliards d’euros qui vise, pour l’essentiel, à diminuer les émissions nettes de CO2 au sein de l’UE suivant un calendrier échelonné. En tant qu’économistes, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir nous prononcer sur la nature des actions à entreprendre dans le cadre de ce plan. Les ingénieurs, agronomes, urbanistes, architectes et autres sont bien plus qualifiés que nous pour ce faire. Néanmoins, il nous apparaît d’entrée de jeu que ce plan focalise sur un seul des grands indicateurs des limites planétaires, les émissions de CO2, et ne s’intéresse pas à d’autres questions comme la disparition de la biodiversité, la disponibilité de l’eau potable, l’acidification de l’eau de mer, etc. Cette focalisation sur un seul chantier le rend de facto insuffisant en termes d’objectifs à atteindre et de moyens financiers à mettre en œuvre et ce d’autant plus que ces moyens financiers résultent pour une bonne partie de détournement de moyens d’autres politiques européennes indispensables (Fonds de développement régional, Fonds social européen, politique agricole) et d’emprunts financiers mutualisés dont la charge d’intérêts pèsera sur les budgets publics même si les États font rouler le capital de la dette. Ce plan s’inscrit dans la trop lente et inachevée prise de conscience des enjeux contemporains par l’immense majorité des dirigeants des institutions internationales et des pays. « Trop peu, trop lent, trop tard » semble être la meilleure illustration de leur action.
2. GPW. Ne pourrait-on imaginer des solutions plus classiques pour impulser la transition environnementale : une hausse du budget de l’Etat et de certains impôts, un prélèvement supérieur sur les « riches » (France stratégie ?), un verdissement de la fiscalité ou des investissements verts ? La logique brutale du marché (hausse des prix dû à la rareté croissante), en dehors de ses aspects purement inégalitaires, peut-elle être techniquement efficace ?
Tout est imaginable et ne rien faire, c’est déjà décider, c’est déjà opter pour un certain type de solution. Il ne vous aura pas échappé que l’on parle de plus en plus d’adaptation au changement climatique et de moins en moins de prévention du changement climatique. C’est dire si le premier chantier est mal embarqué (trop peu, trop lent, trop tard). Alors oui, d’autres solutions sont imaginables et nous ne les écartons pas, mais elles n’offrent pas les mêmes marges de manoeuvre. Dans un espace économique et fiscal ouvert comme l’est l’économie européenne inscrite dans la mondialisation, les traités de libre-échange et la concurrence fiscale internationale, les solutions fiscales ne peuvent venir que de la coopération internationale. Ainsi, la pression des États les plus puissants peut faire avancer les choses et c’est bien sous la pression des USA que le G20 a décidé de mettre en œuvre une taxation à 15% des bénéfices des firmes transnationales comme Google, Amazon, Meta, etc. Certains imaginent une taxation des patrimoines des plus riches. C’est sans doute nécessaire, mais cela ne sera pas simple à obtenir politiquement ça n’a rien d’évident du fait de l’exil fiscal, voire plus simplement de l’optimisation fiscale. Il faudra des années avant de disposer d’inventaires complets de ces patrimoines pour autant qu’ils ne soient pas cachés dans des paradis fiscaux. Par ailleurs, les manifestations des bonnets rouges contre les portails écotaxe, la crise des gilets jaunes déclenchée par la hausse de la taxe à la pompe, et à présent les manifestations des agriculteurs contre la hausse de la taxe sur le GNR démontrent parfaitement qu’alourdir encore la fiscalité des classes moyennes et populaires n’est pas acceptable sans des mesures fortes d’accompagnement social – ce que n’incluent pas non plus les mécanismes d’ajustement par le marché, la hausse du coût de l’énergie ayant des effets sociaux ravageurs. Ce n’est pas en augmentant encore la TVA, l’impôt ou les cotisations sociales sur les revenus du travail ou sur la petite propriété personnelle que l’on trouvera les moyens de financer les gigantesques et indispensables investissements de la bifurcation écologique. La fiscalité verte permettra tout au plus d’orienter les comportements des consommateurs vers des produits et services vertueux mais n’aura jamais vocation à financer les politiques publiques. L’impôt est un outil nécessaire, mais qui touche aujourd’hui ses limites. Les finances publiques sont prises dans un triangle infernal, coincées entre, d’une part, des prélèvements fiscaux limités par la concurrence internationale et le niveau actuel des prélèvements, d’autre part des dépenses largement incompressibles et des gigantesques besoins d’investissement et enfin une dette publique à la limite du soutenable par la charge d’intérêt qu’elle engendre et le chantage au refinancement de la dette par les marchés financiers.
3. GPW. Au-delà du plan purement monétaire discuté ci-dessous, pourquoi ne pas envisager une « planification à l’ancienne » ou bien des formes de protectionnisme (taxe carbone ?) pour protéger les initiatives durables de l’Union ?
Il faut certainement revenir à des formes de planification mais « la planification à l’ancienne" est obsolète. Elle a été conçue dans l’immédiat après-guerre pour rétablir l’économie, rétablir les capacités industrielles, relever la production et la consommation avec des objectifs de croissance et d’emploi. Elle reposait sur un financement par l’endettement pour réaliser des actions financièrement rentables sans réel souci de l’écologie. Ce plan à l’ancienne a parfaitement réussi mais, aujourd’hui, on en paie le prix écologique. Ce prix qui avait été annoncé dès les années 1970 par le rapport Meadows « Halte à la croissance ». Si une nouvelle planification doit être installée, et elle doit l’être, elle sera guidée par des investissements de restauration écologique et sociale, de santé publique ou d’aménagements du territoire, qui devront tenir compte des dimensions économique et financière, mais dont les caractéristiques ne seront pas uniquement pilotées par ces dernières. Ce sera donc une planification différente dont le résultat sera de réaliser des investissements qui ne sont pas nécessairement rentables et qui ne contribuent pas nécessairement à la croissance économique. La planification écologique doit nécessairement avoir une perspective différente de la planification à l’ancienne et mettre en œuvre des moyens différents.
Quant à la taxe carbone, il faudra nécessairement l’inclure dans une réflexion plus large sur la mise sur pied d’une économie circulaire dans laquelle l’humanité cherchera à minimiser ses prélèvements de ressources non renouvelables (les ressources minérales), à pérenniser ses ressources renouvelables (les ressources biologiques) et à minimiser ses rejets dans l’environnement (CO2 et déchets non biodégradables). La taxe carbone n’est qu’un exemple de taxe environnementale appliquée à un certain type de rejet dans l’environnement. Il semblerait assez logique que les prochaines années voient l’éclosion de tout un arsenal de taxes et contributions environnementales diverses tant sur les prélèvements que sur les rejets dans la nature. Mais là encore, il faudra quelques années pour concevoir et mettre cela en œuvre.
4. GPW. Partant de la dimension monétaire de votre ouvrage, ne s’agit-il pas en fait de s’affranchir du PIB en « sortant de la croissance » pour des générations entières « biberonnées au matérialisme » ?
Jusqu’à présent, la croissance économique n’a jamais été décorrélée de l’augmentation des émission de CO2 et des extractions de ressources fossiles, de l’artificialisation des sols, de la chute de la biodiversité, etc. Ceci étant, investir dans la bifurcation écologique et sociale aura pendant une ou deux décennies un effet de relance de la croissance (et de l’emploi !) précisément pour tendre à long terme vers cette décorrélation… avec à court terme un effet rebond à surveiller sur la consommation de ressources et la pollution. Après cela, une croissance verte sera-t-elle possible ? Il est plus vraisemblable que la sobriété économique, notamment énergétique ou en termes de consommation d’espaces naturels, soit nécessaire pour respecter les limites planétaires, ce qui impose de penser un partage équitable des ressources disponibles entre tous les citoyens. Mais l’économie devra toujours conserver une certaine vitalité, un certain dynamisme indispensable au plein-emploi – précisément pour éviter qu’une part de la population, condamnée au chômage, soit exclue de ce juste partage des ressources. Il ne s’agit donc pas d’être pour ou contre la croissance dans l’absolu, mais de prendre en charge ses conséquences à la fois économiques et sociales, et de sortir du « paradigme de la croissance » : elle n’est pas une fin en soi. Surtout mesurée par le PIB, c’est-à-dire la somme des valeurs ajoutées : une hausse de la consommation d’antidépresseurs ou d’opioïde, de la dépendance à l’alcool ou de la vente d’armes à feu contribuent à une croissance du PIB, mais ce ne sont pas pour autant de bonnes nouvelles ! Il ne faut pas fétichiser cet indicateur qui mesure la valeur marchande mais ne dit rien des valeurs d’usage ou du travail domestique non rémunéré : qui épouse sa femme de ménage fait baisser le PIB… Ce n’est qu’un indicateur de production mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour mesurer l’avancée du projet de reconstruction conçue sur une base industrielle, de sorte qu’il est mal adapté à une économie de services : par exemple, les services publics sont évalués à leurs coûts de production, contrairement à la production marchande dont la valeur est intégrée en tenant compte du profit… L’objectif des politiques publiques ne doit donc pas être la croissance du PIB, mais la sécurité économique et le bien-être partagé dans le plein-emploi, la qualité du service public, le respect des limites sociales et environnementales… Notre proposition de réforme monétaire vise justement à trouver des financements au non-marchand, au non-rentable, en sortant du paradigme de la croissance.
5. GPW. Vous déclarez plusieurs fois dans votre essai que « le mode d’émission actuel de la monnaie, de nature bancaire est un verrou ». Le prêt à intérêt, la création monétaire endogène renvoient aux besoins économiques choisis. Mais le système a un défaut majeur : la création monétaire est encastrée dans la dette avec une triple alliance : monnaie-dette-marché. Pourtant la monnaie est un bien commun qui appartient à la collectivité. Pour des générations entières, la formule keynésienne « les crédits font les dépôts », semblait être l’outil majeur d’orientation des dépenses publiques dans les mains de l’Etat…
Dans notre ouvrage Le pouvoir de la monnaie, nous revenons sur la longue histoire de la monnaie et au regard de celle-ci, nous retirons un grand enseignement : « Les grandes bifurcations sociétales sont aussi des grandes bifurcations monétaires. Les unes ne vont pas sans les autres. ». En témoignent ces grands virages monétaires historiques. Les monnaies non marchandes des communautés tribales ne servaient que comme moyen de paiement des dettes de vie (prix de la fiancée, prix du sang pour apaiser un désir de vengeance, sacrifice etc.). Les monnaies de compte de l’antiquité mésopotamienne ou égyptienne ne servaient que pour la comptabilité des dettes centralisées au sein des temples et au Palais, dettes qui étaient généralement payées en nature aux dieux et aux hommes. C’est à partir de la Grèce antique que l’on a utilisé des pièces de monnaie métalliques frappées par le Souverain permettant des échanges décentralisés. Le Moyen-Âge a été une époque de morcellement territorial et monétaire qui a vu émerger les fonctions de changeur et progressivement le développement de moyens de paiement privés par des proto-banques, comme la famille des Médicis, pour faire advenir progressivement la monnaie bancaire actuelle. « L’avènement de la monnaie bancaire au XIXe siècle fut […] une véritable révolution monétaire, qui permit une véritable révolution sociétale, celle du déploiement d’une société industrielle capitaliste. ». Cette monnaie bancaire, encastrée d’abord dans le marché du crédit (les banques la créent en accordant des prêts) et ensuite dans le marché des titres financiers (les banques la créent en achetant des actifs), a été façonnée pour la quête d’accumulation : c’était la monnaie d’un projet capitaliste d’abord marchand, puis industriel et enfin financier, conçue pour la croissance économique, pour faire de l’argent avec de l’argent, pour aller au plus vite au plus rentable.
Ce n’est pas avec cette monnaie bancaire encastrée dans la dette publique et la dette privée, cette monnaie condamnée à la rentabilité financière par le poids des intérêts, que l’on pourra financer les masses d’investissements indispensables mais non rentables que requiert la bifurcation écologique et sociale. La monnaie bancaire créée à la demande d’emprunteurs pour financer des projets financièrement rentables ou prêtée à l’Etat pour assurer les investissements publics ou soutenir la consommation (et donc les entreprises) via des transferts sociaux n’est pas adaptée à un contexte où les investissements écologiques sont massifs et très souvent à rentabilité financière nulle ou négative. C’est là la différence essentielle entre notre position et les positions keynésiennes classiques qui considèrent l’endettement public comme un moyen de relance de l’investissement ou de la consommation qui, par effet retour, va permettre de rembourser l’endettement initial. La croissance ininterrompue de l’endettement public ces 40 dernières années a démontré que cette thèse est discutable et nous prétendons qu’elle l’est d’autant plus si l’endettement est consacré à des investissements écologiques ou sociaux dont la rentabilité financière est nulle ou négative. Quand l’objet dans lequel investir n’engendre pas les conditions du remboursement du capital investi, seule une forte croissance économique peut engendrer les ressources financières permettant le prélèvement d’un impôt indispensable au remboursement de la dette initialement contractée. En conséquence, dans un tel modèle de financement keynésien, il faut faire de la croissance (dommageable à l’environnement) pour obtenir les moyens financiers de réparer l’environnement. Il faut donc détruire quelque chose pour réparer autre chose.
Cependant, notre analyse historique témoigne aussi du fait qu’il est tout à fait possible de faire évoluer le mode d’émission de la monnaie, car c’est une construction sociale, par définition, malléable et adaptable à nos rapports et compromis sociaux. La monnaie, l’institution monétaire est un bien commun qui épouse le projet de société porté par le groupe qui la porte. Nous en déduisons qu’il est nécessaire et possible d’ajouter un nouveau mode de création monétaire désencastré de l’impératif de rentabilité financière et de la dette, qu’il est nécessaire de faire bifurquer l’institution monétaire. Cette bifurcation monétaire que nous proposons viendrait compléter le système monétaire actuel pour le mettre davantage au service du non-marchand en complément du marchand.
MISE EN PRATIQUE ET FONCTIONNEMENT
6. GPW. Le cœur de votre analyse se situe autour de l’idée de création d’une « monnaie volontaire » que vous opposez à la « monnaie marchandisée ». Vous évoquez la monnaie acquisitive (achat de titres ? Opérations non conventionnelles ?). Merci de nous préciser les traits idéaux-typiques de cette opposition et le fonctionnement de la création et destruction de la « monnaie volontaire ». La monnaie volontaire, un bulldozer contre la « forward guidance » ?
La monnaie bancaire est « marchandisée » puisque, au lieu d’être émise en amont des échanges marchands pour les rendre possibles, elle est créée sur le marché bancaire comme nous l’avons expliqué, produite et offerte sur le marché comme une marchandise pour répondre à une demande de liquidités des emprunteurs. La création monétaire est mise en marché. Elle n’est pas seulement encastrée dans la dette, mais aussi dans le marché (du crédit et des titres), c’est-à-dire qu’elle dépend non pas d’une décision administrative (comme si la banque centrale émettait directement la monnaie à destination du Trésor public, fut-ce par la dette) mais d’une multitude de décisions privées décentralisées de banquiers et d’emprunteurs, que la banque centrale ne peut qu’influencer indirectement par sa politique de taux directeurs (le taux auquel elle prête elle-même de la monnaie centrale aux banques, et celui auquel elle rémunère leurs dépôts pour les inciter si nécessaire à épargner leurs réserves de monnaie centrale plutôt qu’à accorder des prêts) et encore plus indirectement par sa politique de forward guidance (c’est-à-dire la communication active des banquiers centraux pour influer sur les anticipations des agents, donc sur leur comportement en matière d’emprunt et de prêt). Le niveau et le rythme d’augmentation ou de diminution de la masse monétaire n’est que sous le contrôle partiel de la banque centrale (qui parfois peine grandement à atteindre ses objectifs, comme entre 2015 et 2019 en zone euro, où l’inflation était deux fois plus basse que voulu), de même que l’affectation des encaisses émises : c’est le marché (bancaire) qui décide.
A l’origine, les banques ne créaient la monnaie que par l’octroi de crédits : c’est ce que nous appelons le « mode bancaire traditionnel » d’émission. Mais depuis les années 1980, avec la financiarisation de l’économie, elles ont déployé leur activité sur les marchés financiers et se sont mises à créer la monnaie de plus en plus (et aujourd’hui majoritairement) en achetant des actifs, des titres financiers. C’est ce que nous appelons le « mode bancaire acquisitif » de création monétaire. L’émission de monnaie est dès lors encastrée dans le marché des titres, et pas seulement du crédit. cela opère un premier désencastrement partiel de la création monétaire par rapport à la dette, puisque les actifs achetés peuvent ne pas être des titres de dette mais des titres de propriété (actions, or, cryptoactifs comme le Bitcoin…) ou des produits dérivés assurantiels, mais aussi parce que même quand la banque achète une créance (bon du Trésor, obligation d’entreprise, créance hypothécaire titrisée…) ce n’est pas forcément à l’émission, sur le marché primaire, mais potentiellement aussi à la revente, sur le marché secondaire : dans ce cas, l’argent créé ne va pas à l’emprunteur, mais au créancier initial qui revend la créance, de sorte qu’il n’y a pas formation d’une dette supplémentaire – simplement substitution de créancier sur une dette existante au moyen d’une création monétaire. Dès lors, l’argent créé n’est pas injecté dans l’économie réelle, mais tend à circuler simplement sur les marchés financiers, nourrissant des bulles.
En outre, le crédit bancaire a lui-même évolué, allant de moins en moins financer la production des entreprises, et de plus en plus des achats immobiliers par les ménages ou des achats de titres financiers par des institutions financières : il a donc lui aussi été détourné vers une logique acquisitive plutôt que productive, spéculative plutôt qu’industrielle, et a contribué à nourrir des bulles financières et immobilières. Enfin, depuis la crise des subprimes (et même avant au Japon), les banques centrales se sont elles aussi converties au nouveau modèle d’activités des banques en déployant, en plus de leurs prêts aux banques, des programmes d’achats d’actifs massifs : ce sont les fameuses politiques non conventionnelles d’assouplissement quantitatif (quantitative easing ou QE), auxquelles la BCE s’est ralliée en 2015. C’est une rupture majeure : la puissance publique ne se contente plus d’influencer indirectement le marché bancaire, mais reprend partiellement le contrôle de la création monétaire en agissant directement sur la quantité de monnaie en circulation. Le QE n’a pas relancé la demande adressée à l’économie réelle, il a surtout servi à soutenir directement les cours de bourse pour empêcher l’éclatement de la bulle financière, et à garantir aux Etats surendettés l’accès à des liquidités abondantes pour empêcher l’explosion de leurs taux d’emprunt (même si la BCE, n’ayant pas le droit de prêter directement aux États, a racheté leur dette sur le marché secondaire et non primaire).
Toutes ces évolutions témoignent de l’extraordinaire malléabilité de l’institution monétaire, qui continue de se transformer à notre époque. Malheureusement, ces mutations n’ont fait pour l’instant que soutenir le capitalisme sans le transformer, approfondissant même sa financiarisation. De notre côté, nous prônons, au contraire, une bifurcation monétaire au service du non-marchand, du non-rentable, du bien commun. Le mode « volontaire » de création monétaire serait un nouveau mode d’émission complémentaire au mode bancaire d’émission, désencastré de la dette et du marché bancaire. Concrètement, un Institut d’émission pourrait décider la création de monnaie légale (fongible avec le reste de la masse monétaire) sans prêt ni achat de titres, et transfèrerait gratuitement les encaisses émises à une Caisse de développement durable chargée de les distribuer dans l’économie réelle en dehors de toute dette, par des subventions aux investissements indispensables mais non rentables qui sont au cœur de la bifurcation écologique et sociale, aux échelles locale, régionale, nationale, et, bien sûr, européenne. Nous aurions donc là une « monnaie volontaire », expression d’une volonté collective, centrée sur des projets non marchands sans rentabilité financière, en complément de la « monnaie bancaire », expression d’une volonté privée, centrée sur des projets personnels à vocation de rentabilité financière. Associés à ce projet de réforme du mode d’émission, différents dispositifs monétaires, financiers et fiscaux d’accompagnement viendraient réguler le stock de monnaie en circulation.
7. GPW. La « monnaie volontaire » est-elle démocratique ? Une forme de « monnaie hélicoptère » ?
Comme la monnaie hélicoptère, la monnaie volontaire est émise en dehors de toute dette. Mais au lieu d’être distribuée sans conditions aux ménages ou entreprises pour relancer la demande en temps de crise (instrument conjoncturel), la monnaie volontaire (instrument structurel) est ciblée sur les investissements (les subventions distribuées ne peuvent pas être utilisées pour la consommation ou l’épargne), financièrement non rentables mais écologiquement ou socialement souhaitables : l’autorité monétaire publique reprend ainsi partiellement le contrôle non seulement sur la quantité de monnaie émise dans l’économie, mais aussi sur l’affectation des encaisses (du moins la primo-affectation : l’argent créé est fléché sur tel ou tel usage lors de l’octroi de subventions, mais ensuite, étant parfaitement fongible avec le reste de la masse monétaire, il circule librement dans l’économie). Ce nouveau mode d’émission est donc véritablement conçu pour réaliser des projets d’intérêt général, financer des biens communs et des biens publics, ou des investissements privés non rentables mais à fort impact environnemental ou social. Ces caractéristiques particulières exigent une gouvernance particulière, conforme aux objectifs poursuivis, et ce tant dans la définition des montants de monnaie à émettre que dans l‘affectation initiale des sommes créées. C’est pourquoi, nous proposons de mettre en place une gouvernance collégiale, démocratique, largement ouverte sur la société civile et les organisations représentatives des différents corps sociaux (syndicats, associations de défense de l’environnement, élus locaux, organismes de santé publique, offices HLM, etc.) tant au niveau de l’Institut d’émission en charge de définir les montants de monnaie à émettre que des caisses de développement durable chargées de l’attribution des subventions et du suivi de leur bonne utilisation. De cette manière, la monnaie volontaire serait véritablement la monnaie de la société civile, une monnaie qui ne serait ni à la main des banquiers, ni à la main d’une technocratie étatique.
8. GPW. La plasticité de la monnaie est une de ses qualités, et l’Histoire le prouve mais attardons-nous maintenant sur le schéma institutionnel (Institut d’émission et Caisse de développement durable). Que deviennent l’indépendance de la BCE et les Traités de l’UE ?
Techniquement, la monnaie centrale serait toujours émise par la banque centrale, que ce soit par le mode bancaire traditionnel (les prêts qu’elle accorde aux banques pour les refinancer), le mode acquisitif (le QE) ou le mode volontaire (les émissions hors dette). Mais dans le cas du mode volontaire, la décision reviendrait à un Institut d’émission, dont la gouvernance collégiale inclurait toutes les parties prenantes du développement durable, la banque centrale ne faisant qu’exécuter. Dans le cas de la zone euro, cela pose une difficulté par rapport aux traités européens (problème qui ne se poserait pas tant en Angleterre, en Suisse ou au Japon, par exemple, où la banque centrale est indépendante également mais où il n’y aurait pas besoin de mettre plusieurs pays d’accord pour réformer sa gouvernance).
La difficulté en question ne réside pas dans le fait que la BCE financerait les États : la monnaie volontaire doit être créée à destination de ménages, d’entreprises et d’associations aussi bien que d’organismes publics. Pour ces derniers, l’article 123 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) interdit explicitement à la banque centrale d’accorder des découverts ou des crédits aux administrations publiques, et d’acquérir directement auprès d’eux les instruments de leur dette (d’où le fait que le QE passe par le marché secondaire, l’acquisition indirecte, auprès des créanciers initiaux, des instruments de la dette des Etats : ce sont les banques privées qui prêtent aux Etats, et quelques minutes après elles revendent les obligations souveraines à la BCE). Mais donner de l’argent gratuitement aux États ou aux collectivités, en dehors de toute dette, n’est pas formellement interdit – or en droit, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. C’est peut-être contraire à l’esprit de l’article 123, si l’on considère que celui-ci ne vise pas qu’à limiter l’endettement public mais aussi à lutter contre un risque de surémission (l’article 127 du TFUE précise que l’objectif prioritaire de la BCE est la stabilité des prix, tout autre objectif – y compris donc aider les États à sauver la planète ! – étant soumis à ce préalable), mais ça ne l’est certainement pas autant que le QE qui a permis à l’autorité monétaire publique de créer des milliers de milliards d’euros à destination des marchés et facilité l’endettement des États, participant donc à la hausse de l’endettement public, ce que ne ferait en aucun cas la monnaie volontaire. La réelle difficulté avec les traités européens réside plutôt dans l’indépendance de la BCE, consacrée par l’article 130 du TFUE qui lui interdit de solliciter ou même d’accepter des instructions de tout organe public de l’Union européenne ou des États membres – donc d’un éventuel Institution d’émission, même si sa gouvernance collégiale était ouverte sur la société civile. Dès lors, la solution idéale serait de changer les traités, mais cela exige l’unanimité des États membres. Nous proposons donc, pour le cas de la zone euro, une deuxième option, un compromis provisoire : créer l’Institut d’émission au sein de la BCE, comme un conseil interne dont les avis éclaireraient les décisions du Conseil des gouverneurs sans pouvoir s’imposer à lui. Dans ce cas, malheureusement, la technocratie de la banque centrale, indépendante de tout contrôle politique démocratique, garderait la haute main sur les émissions de monnaie volontaire.
9. GPW. Pourriez-vous évoquer un ou deux exemples pratiques de son application (ménage/et ou entreprise) ?
Les agents porteurs d’un projet d’investissement à fort impact écologique et social mais dépourvu de rentabilité financière pourraient déposer un dossier de demande de subvention auprès de la caisse locale du développement durable quel que soit leur statut :
– Des particuliers : par exemple un ménage pauvre devant réaliser l’isolation thermique de son logement sans qu’il soit certain que les économies d’énergies qu’il pourra ainsi réaliser permette de rembourser un éventuel emprunt, même à très long terme…
– Des associations : une association de protection de l’environnement qui déploie un programme de plantation de forêts natives selon la technique Miyawaki ou de restauration du bocage par la plantation de haies entomofaunes, pour contribuer à maintenir ou restaurer la biodiversité et capter du CO2.
– Des personnes publiques : un hôpital qui veut investir dans un nouveau scanner, une université qui doit réaliser des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, une maison de retraite qui manque de financements pour augmenter ses capacités d’accueil en réponse à l’augmentation de la population âgée, un département qui souhaite ouvrir un centre d’hébergement d’urgence face à la hausse du nombre de sans-abris, un bailleur social qui veut créer de nouveaux logements à loyer très modérés dans une métropole où les prix de l’immobilier sont très élevés), etc.
– Des entreprises publiques : la SNCF devant revitaliser les anciennes petites lignes ferroviaires rurales pour promouvoir l’écomobilité même sans rentabilité économique.
– Des entreprises privées : une cimenterie privée qui doit réduire ses émissions de carbone alors que celles-ci, liées au traitement du calcaire et non à la source d’énergie utilisée, ne peuvent être évitées et doivent être stockées, ce qui exige d’investir dans une technologie de capture et stockage du carbone (CSC) qui doublera les coûts de production sans générer de nouvelle recette et menacera la pérennité de l’entreprise.
– Des entreprises agricoles qui entreprendraient un parcours de reconversion de leurs pratiques pour les inscrire dans un modèle agro-écologique qui entraînerait des pertes d’ exploitation pendant la période de reconversion et qui nécessiterait des investissements écologiques au profit de la biodiversité, de la rétention des eaux pluviales dans les nappes phréatiques.
– Des entreprises de l’économie sociale et solidaire : une recyclerie de quartier à but non lucratif, un garage coopératif de réparation de voitures et de vélos, un atelier de réparation d’électronique et d’électroménager devant réaliser des investissements dans des machines permettant d’allonger la durée de vie des produits et donc de lutter contre la surconsommation.
Pour développer davantage un exemple, prenons le cas d’une commune qui veut déployer un programme de ville-éponge pour permettre une meilleure absorption des eaux pluviales en cas de fortes intempéries (appelées à se multiplier du fait du dérèglement climatique) et éviter ainsi les inondations dévastatrices liées à l’imperméabilisation des sols comme à la Nouvelle Orléans en 2005 (inondée à 80 % par l’ouragan Katrina, contre seulement 20 % lors de l’ouragan Betsy, de même intensité, en 1965, alors qu’entretemps, des digues et des drains avaient été bâtis, mais aucun espace vert) ou à Wuhan en 2016 (jadis surnommée « la ville aux cents lacs », mais dont les trois quarts des 127 lacs avaient disparu depuis les années 1980 à cause de l’artificialisation des sols). La création d’espaces verts ou d’étangs participe aussi à la reconstitution des nappes phréatiques (et donc à la lutte contre les sècheresses qui elles aussi seront de plus en plus nombreuses avec le réchauffement climatique), à la constitution d’îlots de fraicheur (donc à la lutte contre les canicules de plus en plus fréquentes), à l’instauration de réserves de biodiversité urbaine, à des espaces verts contribuant au stockage du carbone donc à la qualité de l’air en ville, et enfin à la qualité de vie. Mais tous ces services écologiques indispensables exigent des investissements massifs dépourvus de rentabilité proprement financière. En effet, il faut acquérir du foncier bâti aujourd’hui hors de prix dans des métropoles touchées par la mondialisation et la financiarisation des marchés immobiliers, pour les convertir en parcs ou en lac ne produisant aucune recette : c’est donc un pur coût, une dépense sans retour financier pour la collectivité locale (qui s’ajoute à d’autres : reconstruction des revêtements des routes en matériaux poreux, création d’aires de jeu convertibles en bassin de rétention des eaux pluviales, etc.). C’est ce qu’illustre l’exemple de la friche Kodak à Sevran : après dix ans de travaux de dépollution aux frais de l’entreprise (30 M€ pour excaver 100 000 tonnes de terres polluées et traiter par oxydation chimique les eaux contaminées de la nappe phréatique), le coût net pour la municipalité a été de 7,25 M€ pour acquérir le foncier et mener un programme de renaturation à 600 000 € pour maintenir une zone naturelle de 9,2 ha (planter de l’herbe, des arbres et des plans d’eau, qui ne rapportent rien financièrement). Si la monnaie volontaire existait, la ville aurait pu soumettre à la Caisse départementale du développement durable une demande de subventions : son projet répondant à la grille de critères fixées démocratiquement, elle aurait ainsi reçu tout ou partie des fonds nécessaires sans avoir à s’endetter ou à augmenter ses impôts locaux, car la lutte contre l’artificialisation des sols est un enjeu crucial de la bifurcation écologique. En France, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers augmente plus rapidement que la croissance démographique, avec 20 à 30 000 ha artificialisés chaque année, principalement pour l’habitat. L’article 191 de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 prévoit la réduction de moitié du rythme d’artificialisation au cours de la décennie, et l’atteinte du Zéro Artificialisation Nette en 2050, en tenant compte du besoin de nouveaux logements.
ACCEPTABILITÉ ET ÉLARGISSEMENTS
10. GPW. L’on comprend qu’une gouvernance partagée évitant toute « capture de la puissance collective » de la monnaie sont des exigences techniques et morales. Mais comment faire accepter votre schéma institutionnel, en particulier sa mise à l’agenda ? L’on sait par exemple que l’attachement à la stabilité monétaire est culturel pour l’Allemagne.
De plus en plus touchée par des inondations spectaculaires, l’Allemagne est aussi de plus en plus consciente de l’urgence des enjeux écologiques. Durement touchée par l’inflation, avec des conséquences économiques et sociales sévères, elle est aussi consciente de la nécessité de s’émanciper de la dépendance au gaz russe ou au GNL américain : à long terme, investir dans la bifurcation écologique et sociale est le meilleur moyen de lutter contre l’inflation, qui est de plus en plus liée à l’énergie et à l’agriculture (impactée par le réchauffement) et de moins en moins d’origine monétaire. N’oublions pas non plus que le mouvement des agriculteurs qui a secoué toute l’Union européenne est parti d’Allemagne… À tous les niveaux, un changement de modèle s’impose. Espérons que les élections européennes de juin permettront de réelles avancées en termes de bifurcation écologique et sociale… et monétaire !
La question de la stabilité monétaire ne peut être écartée. La monnaie volontaire aurait cette spécificité de ne pas comporter de mécanisme de reflux intrinsèque, rôle que joue le remboursement des dettes dans le cas de la monnaie bancaire (traditionnelle ou acquisitive) : l’émission hors dette permet d’augmenter facilement la masse monétaire pour répondre au besoin de financement des projets indispensables mais non rentables, mais ne contient pas en elle-même de quoi réduire la masse monétaire, de sorte qu’un mécanisme ad hoc doit lui être adjoint pour parer au risque d’inflation monétaire. Nous avons imaginé tout d’abord un mécanisme fiscal organisant un reflux régulier des encaisses vers la Caisse du développement durable :
– Une double compensation écologique : taxe sur les rejets polluants (émissions de CO2 et déchets non biodégradables) et contribution sur les prélèvements de ressources minérales non renouvelables (hydrocarbures, minerais…).
– Une double contribution monétaire : micro-taxe sur les stocks de monnaie (les dépôts à vue et/ou les réserves excédentaires des banques à la banque centrale) et micro-taxe sur les flux de monnaie (les transactions financières voire l’ensemble des paiements bancaires).
Ainsi, un flux régulier d’encaisses reviendrait structurellement au réseau des Caisses du développement durable, ouvrant deux options : les réinjecter pour continuer à financer la bifurcation en recourant moins à de nouvelles émissions, ou bien, s’il y a trop de monnaie en circulation, la restitution de tout ou partie de ces fonds à la banque centralepour destruction monétaire (décidée par l’Institut d’émission en fonction du contexte macroéconomique : inflation, chômage, niveau des stocks, taux d’utilisation des capacités de production, perspectives de croissance…).
À ce mécanisme de destruction de monnaie volontaire s’ajoutent d’autres instruments classiques de la politique monétaire qui permettent de réguler la masse monétaire totale en réduisant plutôt la quantité de monnaie de crédit (hausse des taux directeurs ou du taux de réserves obligatoires des banques) ou la quantité de monnaie acquisitive (rétrécissement quantitatif par vente des titres détenues par la banque centrale dans le cadre du QE), ou en réduisant la masse monétaire totale sans distinction de son origine volontaire, acquisitive ou de crédit (selon les besoins, emprunt de long terme réalisé par la banque centrale auprès des épargnants, ce qui créerait un produit d’épargne populaire sûr, ou opération de reverse repo de court terme auprès des banques).
Ainsi, nous prévoyons tout un arsenal d’outils fiscaux et monétaires permettant une gestion fine de la politique monétaire pour éviter tout dérapage inflationniste.
On peut aussi mettre en avant que l’émission de monnaie volontaire réduirait peu à peu la part de dette dans l’économie (autre sujet de préoccupation des Allemands), d’une part parce que son émission n’ajoute pas de dette et, d’autre part, parce que la circulation de cette monnaie permanente donnerait de quoi rembourser les dettes passées ; cela renforcerait la solvabilité des acteurs privés et publics et réduirait les risques pris par leurs financeurs, facilitant leur activité, y compris celle des banques.
11. GPW. Pour être direct, n’est-ce pas d’abord une réforme des Institutions européennes qui est nécessaire ?
Les institutions européennes devraient assurément être réformées, pour démocratiser la gouvernance (par exemple en donnant au Parlement l’initiative et le dernier mot en matière législative et la capacité de nommer et renverser la Commission ou le banquier central), déployer un protectionnisme solidaire aux frontières de l’Union, autoriser les politiques industrielles, les monopoles publics et la préférence locale dans les commandes publiques en dérogation au dogme de la concurrence libre et non faussée, décupler le budget européen en renforçant les ressources propres, organiser la planification éco-sociale et l’aménagement du territoire, harmoniser par le haut le niveau de la fiscalité et de la protection sociale, etc. Notre proposition de monnaie volontaire s’inscrit dans cet indispensable changement de paradigme, qui devrait nous sortir d’une Europe néolibérale, pilotée par une technocratie hors sol avec un haut degré de capture par les lobbies des multinationales, et structurée autour du libre-échange, de la libre circulation des capitaux, de la concurrence fiscale et sociale, etc., pour construire enfin une Europe écologique et sociale, respectueuse de l’humain et des limites planétaires. Mais le passage de l’Europe du capital privé à l’Europe des peuples et de l’intérêt général exige une refonte des traités européens, à l’unanimité des États membres, ce qui risque de rester un vœu pieu tant qu’une crise majeure ou une réelle volonté politique ne vient pas changer la donne. C’est pourquoi nous avons tenu à proposer une deuxième version de notre réforme qui, loin d’être idéale, soit au moins compatible avec les traités actuels.
12. GPW. Au niveau de la population, comment faire passer le message complexe du pouvoir monétaire en bifurcation ? L’on voit bien la résistance au changement de modèle de certains agriculteurs (question des normes) ou bien pour l’automobile voire pour le logement. Votre essai ne va-t-il pas dans le sens d’ « une surévaluation du désir de biens communs » ?
Le rejet du modèle existant est patent, dans tous les domaines (agriculture, retraites, travail, environnement, santé, etc.) : tous les secteurs sont en crise (dans le public comme dans le privé, la désindustrialisation ayant été concomitante de la casse des services publics) et le climat social, de plus en plus éruptif, risque de se traduire dans des résultats électoraux teintés d’amertume et d’agressivité. Les résistances au changement existent, mais surtout quand ce changement est imposé sans équité et sans mesure d’accompagnement social. Il ne faut pas caricaturer : nos agriculteurs ne sont pas plus antiécologiques que ne l’étaient les Gilets Jaunes, même si dans les deux cas c’est la hausse de la taxe sur le carburant qui a mis le feu aux poudres. Le discours anti-normes des capitalistes ultra-libéraux de l’agrobusiness qui tiennent la FNSEA ne doit pas nous faire croire que nos agriculteurs, en première ligne face aux sècheresses ou aux inondations, ne sont pas conscients des périls écologiques. Mais comment exiger d’eux qu’ils produisent sans pesticides et se convertissent à l’agriculture biologique ou à l’agro-écologie si le marché européen demeure ouvert à la concurrence des produits agricoles importés de pays où les mêmes normes n’existent pas ? C’est de la concurrence déloyale institutionnalisée et la mort assurée pour nos agriculteurs ! De même pour les Gilets Jaunes : comment augmenter les taxes sur le carburant que doivent payer des ménages pauvres qui ne peuvent se passer de la voiture du fait de l’absence de politique d’aménagement du territoire, abandonnée depuis des décennies à la régulation marchande, c’est-à-dire à la croissance sans fin des aires périurbaines autour des métropoles mondialisées, et à la désertification des villes moyennes ? On laisse les individus les plus exposés assumer seuls les conséquences de nos choix de société : c’est tout l’inverse de la monnaie volontaire, instrument collectif de financement d’un nouveau projet de société.
La monnaie volontaire est justement un moyen de répondre aux enjeux de la bifurcation sans augmenter les impôts (ni la dette publique), et de mieux protéger les populations, qui seront de plus en plus vulnérables face au changement climatique et qui ont une demande de protection croissante. Prenons le cas des ostréiculteurs du bassin d’Arcachon : ce sont les fortes pluies de cet automne (215,4 mm d’eau tombés en France métropolitaine en 26 jours : c’est le record de précipitations depuis 1993, 40 % au-dessus de la moyenne des trente dernières années) qui, en saturant les stations d’épuration du littoral atlantique, ont provoqué un déversement des eaux usées dans la mer et une infection des huîtres au norovirus, contaminant ensuite des milliers de consommateurs et menant à l’interdiction des ventes pour 4 semaines, nouvel an compris (soit une perte de 15% à 30% sur le chiffre d’affaires annuel des ostréiculteurs : 7M€ ont été perdus rien que dans le bassin d’Arcachon). Cela pose à l’évidence un problème d’accompagnement social, mais aussi de lutte contre le réchauffement climatique, puisque c’est encore lui qui est à l’origine du problème : cet automne, les températures avaient été en France 2,5° au-dessus des moyennes saisonnières, or la hausse des températures de l’air et des océans, qui charge l’air d’humidité, est la cause des fortes pluies qui ont tout déclenché…
Enfin, puisque le réchauffement est désormais irréversible et ne peut plus qu’être limité mais pas évité, il est nécessaire de s’y adapter : en l’occurrence, il y a un gros enjeu d’adaptation des infrastructures d’assainissement. Hervé Berville, Secrétaire d’État à la mer, a déclaré qu’il était nécessaire d’augmenter l’investissement des collectivités locales dans les systèmes de traitement des eaux usées, mais avec quels financements ? La monnaie volontaire pourrait typiquement répondre à ce genre de problématique. Un travail de pédagogie est donc nécessaire pour montrer que la bifurcation n’est pas un projet de contrainte, mais d’abord et avant tout un projet de protection !
13. GPW. Que répondez-vous à ceux qui déclarent que les dépenses non rentables doivent être financées par l’impôt (IRA = subventions), mais aussi que votre proposition est budgétaire in fine (Agnès Bénassy-Quéré)… ?
Nous leur répondons que si l’impôt et la dette leur semblent être les modes de financement adéquats de la transition écologique, alors force est de constater qu’il en faudrait davantage puisque toutes les estimations, aussi étroites soient-elles (car le plus souvent resserrées autour de la seule transition climatique, sans même prendre en compte la biodiversité, ni les autres indicateurs écologiques, ni les dépenses d’accompagnement social et sectoriel) montrent qu’il manque 2 à 4 points de PIB d’investissements privés et publics par an jusqu’à au moins 2030. On notera que ces projections ne donnent jamais une estimation précise de la part et a fortiori du montant d’investissements non rentables nécessaires et qu’elles en minimisent mécaniquement la part en retenant une conception étroite de la transition dans une approche plutôt en termes de croissance verte qu’en termes de bifurcation sociale-écologique. Même en s’en tenant à ces estimations a minima, quelles sont les marges de manœuvre pour accroître les recettes fiscales et la dette publique ? Elles nous semblent extrêmement limitées comme nous le relevions déjà au début de cet échange. Nous ne sommes pas du tout opposés à la mise en place d’un impôt sur la fortune « vert », ni à celle d’une taxation des transactions financières (TTF), dont le produit pourrait aller dans les deux cas au financement d’investissements publics dans la transition. Mais la recette d’un ISF vert ne suffira pas : le rapport « Pisani-Ferry & Mahfouz » évaluait à 150 Mds € les recettes d’une taxe exceptionnelle de 5% appliquée à l’actif financier net des 10% les plus aisés (estimé à 3000 Mds), ce serait une bonne contribution, mais qui ne suffirait à financer les 34 Mds d’investissements publics annuels supplémentaires (pendant 7 ans, soit en tout 238 Mds) qu’ils estiment nécessaires (en se limitant pourtant à la transition climatique). Y ajouter le produit d’une TTF serait très bien aussi, mais ce serpent de mer nous échappe depuis des années, les initiatives en la matière étant systématiquement contrées par le lobby bancaire et financier : on peut légitimement douter d’y parvenir plus vite qu’avec la monnaie volontaire et à un niveau suffisant.
Les taxes environnementales que l’on peut envisager aussi (et que nous n’écartons absolument pas de notre dispositif, on s’en sert au contraire) ne seraient pas suffisantes non plus, d’autant que pour les rendre équitable – condition sine qua non de leur acceptation sociale – il faut en redistribuer une grande part du produit, ce qui réduit d’autant la part des recettes utilisables pour financer des investissements, ou les accompagner d’un dispositif d’accompagnement comme celui que permet la monnaie volontaire.
Suffirait-il sinon de combiner un peu plus d’impôts et un peu plus de dette ? Augmenter la dette continûment, fut-elle celle des États, n’est pas possible sans élever son risque d’insoutenabilité. Les États sont inégaux face à ce risque, la zone euro en a fait la douloureuse épreuve pendant sa crise de dettes souveraines entre 2010 et 2012 – la Grèce, le Portugal et l’Espagne souffrant davantage de la défiance des investisseurs que l’Allemagne, la France occupant une délicate place intermédiaire. Une Union budgétaire entre les États membres de la zone euro réduirait ce risque en le mutualisant, mais le chemin de cette union reste assez fermé en dépit de l’emprunt mutualisé effectué par la Commission européenne pour financer une grande part des 850 milliards du plan de relance Next Generation EU (cet emprunt n’a été accepté qu’à la condition de ne pas recourir à nouveau à ce type de solution et sous la garantie que les autres budgets européens seraient utilisés pour rembourser cette dette). Si les États-Unis apparaissent encore comme le pays ayant le plus les coudées franches au plan budgétaire, les investisseurs assimilant les bons du Trésor américain à de la quasi-monnaie, même à leur niveau commence à se poser la question de la soutenabilité de la dette. La tension montante chaque année autour du plafond de dette à négocier au Sénat montre que même les États-Unis ne sont pas complètement à l’abri d’une crise budgétaire, et surtout que le financement par la dette expose à diverses pressions : créanciers et politiques peuvent toujours prendre le prétexte de la dette pour exiger de compresser les dépenses. La monnaie volontaire nous affranchirait de cela. Il ne s’agit pas de l’utiliser pour tout. Les impôts et la dette doivent continuer de financer les dépenses courantes mais pour les dépenses d’investissement public, a fortiori non rentables, mieux vaut un financement monétaire alternatif sans dette comme celui que permettrait une émission de monnaie volontaire.
Et même si les règles budgétaires étaient, contre toute attente, desserrées, au niveau de l’Union européenne – alors même que la récente réforme des régles budgétaires a au contraire maintenu les ratios de dette et de déficit – une émission de monnaie volontaire demeurerait un mode de financement souhaitable car permettant de financer plus, mieux et surtout de façon plus cohérente que par l’endettement les investissements indispensables non rentables dont on a besoin :
– « Plus », parce qu’un financement par la dette requiert un remboursement et un paiement d’intérêt, ce qui signifie qu’on ne peut l’utiliser que pour financer des investissements rentables. C’est à la part non rentable des investissements que serait affectée l’émission de monnaie volontaire.
– « Mieux », parce que la dette installe un rapport de dépendance de l’emprunteur vis-à-vis du créancier qui rend ce dernier apte à exercer une pression, une dépendance de la puissance publique au marché alors que la monnaie volontaire modifie cette pression pour la placer sur les auteurs de projets qui présentent des avantages pour la collectivité.
– « Plus cohérent », parce qu’il faut de la croissance pour rembourser la dette. La dette est l’instrument d’une société de la croissance alors que, comme nous le disions plus haut, le respect des limites planétaires implique de changer d’objectif. La monnaie volontaire serait aussi un moyen de financement de la transition écologique plus cohérent que la dette du point de vue de ses effets distributifs : la détention de titres de dette enrichit les plus riches alors que son remboursement incombe à tous. La monnaie volontaire ne présente pas cet inconvénient et permet de concilier pleinement transition écologique et transition sociale. La monnaie volontaire, pleinement désencastrée des marchés financiers et du marché du crédit, viendrait en outre mettre un frein à la financiarisation quand la dette, au contraire, l’alimente.
Notez bien, par ailleurs, que l’émission de monnaie volontaire ne viendrait pas abonder le budget général de l’État. Dans notre schéma, la monnaie volontaire, émise par la banque centrale à la demande de l’Institut d’émission, va à la Caisse de développement durable qui la distribue sous forme de subventions à tout un ensemble d’agents aussi bien privés que publics pour réaliser des projets utiles pour le collectivité. Le budget général de l’État demeure financé par l’impôt et la dette et pourrait alors se concentrer sur les dépenses courantes et les dépenses d’investissements rentables, tandis que l’émission de monnaie volontaires irait aux investissements indispensables mais non rentables (publics et privés). On en viendrait ainsi à une nouvelle expression de la règle d’or en matière budgétaire dans laquelle le budget ordinaire et les investissements rentables seraient financés par l’impôt et une dette de marché dans les limites fixées et où les investissements de bifurcation sociale et écologique seraient financés par des émissions monétaires volontaires accompagnées de mesures de contrôle de la masse monétaire en circulation.
Enfin, on nous dit que la création de monnaie sans dette, donc sans contrepartie comptable, sans actif saisissable et rapportant des intérêts à l’actif de la banque centrale, serait finalement un acte budgétaire car elle ferait perdre des revenus et du patrimoine à l’État en tant qu’actionnaire de la banque centrale. Outre que la banque centrale n’a pas pour mission d’engranger des dividendes pour les États (sa structure actionnariale n’est au fond qu’un héritage ininterrogé de son ancien statut de banque privée), cela ne produirait pas plus de pertes qu’aujourd’hui. Depuis que les taux sont remontés, les banques centrales creusent en effet leurs pertes en rémunérant les réserves des banques (en zone euro, la BCE rémunère depuis septembre 2023 les réserves excédentaires des banques commerciales à 4%, ce qui sur un an pour un montant de réserves d’environ 3 682 milliards d’euros à fin septembre 2023, représente 146 milliards d’euros de subventions). Ces pertes font que les grandes banques centrales n’ont actuellement rien à redistribuer à leur État actionnaire et parfois même le mettent à contribution pour éponger la perte. C’est le cas en Angleterre par exemple, cela pèse alors sur les finances publiques et n’a pourtant rien d’indispensable car une banque centrale peut fonctionner avec des pertes : la BRI elle-même rappelle depuis 2013 que des fonds propres durablement négatifs ne l’empêchent en rien d’accomplir sa mission, et que rien n’impose dans ce cas de la recapitaliser. Quoi qu’il en soit, ces questions qui nous font entrer dans les arcanes de la comptabilité de banque centrale devraient déboucher sur une réflexion quant à la pertinence du schéma comptable des banques centrales hérité de l’époque où elles étaient des banques privées poursuivant des intérêts exclusivement mercantiles. En attendant le résultat de cette réflexion, la solution comptable que nous préconisons pour la monnaie volontaire consisterait à inscrire au bilan de la banque centrale un poste d’actif irrécouvrable où serait enregistré le montant émis, de sorte qu’il n’y aurait ainsi pas de perte à enregistrer ni a fortiori à compenser.
14. GPW. La rupture systémique que vous proposez peut-elle fonctionner dans un monde de compétition économique et géopolitique ?
Bien sûr que tout ce qui peut se faire à une échelle globale, coordonnée entre tous les États, vaut mieux que des initiatives isolées. Cependant vouloir que tout se fasse à l’échelle internationale et conditionner l’action à cela est la meilleure façon de ne rien faire. Opposer à une proposition d’action qu’elle n’aura pas d’efficacité si elle n’est pas réalisée dans le monde entier relève plus de la rhétorique de l’inanité (pour reprendre les termes d’Albert Hirschman dans Deux siècles de rhétorique réactionnaire, 1991) que d’une réelle volonté de faire avancer les choses. Ce que nous proposons ne peut certes pas s’envisager à l’échelle d’un seul pays de la zone euro, c’est a minima pour chaque pays appartenant à la zone euro à l’échelle de la zone tout entière que cela doit s’envisager puisqu’il s’agit de faire émettre des euros sans dette à chaque banque centrale nationale dans des volumes coordonnés de manière équitable pour tous les États membres Imaginons que ce dispositif soit mis en place en zone euro, il nous semblerait plus important de veiller à ce qu’il fonctionne bien aux échelles nationales et locales pour assurer la réalisation des investissements de transformations au plus près des besoins dans les territoires, que de faire du prosélytisme international. Le dispositif parlera de lui-même : s’il permet de réaliser des transformations qui jusque-là n’étaient pas possibles, il fera des émules.
Peut-être qu’un certain nombre de pays émergents ou en développement, sur le continent africain notamment, gagneraient aussi à adopter un mode d’émission de monnaie légale libre de dette car ce mode volontaire d’émission monétaire serait un moyen pour eux de s’affranchir, dans une certaine mesure, des contraintes de financements extérieurs, et de gagner en autonomie de financement.
15. GPW. Partant de l’idée que la monnaie objective d’abord des rapports de force, ne faudrait-il pas faire de l’euro d’abord une monnaie géopolitique ? Un rôle géopolitique fort pour considérer alors les enjeux climatiques ? Une Europe normative qui deviendrait alors Europe puissance et proactive.
Mais l’euro a été conçu dès le départ comme une monnaie géopolitique ! Il répondait à deux objectifs :
1) D’une part, l’euro était un projet d’unification économique, marchande, mais aussi symbolique du continent européen, le problème étant qu’on ne peut réaliser l’unité économique et politique par la monnaie seule… surtout sur une zone aussi peu homogène en termes de développement agricole, industriel et financier mais aussi philosophique, religieux, éducatif ou social. Sans cesse frappée par des chocs asymétriques, avec des taux de chômage, de croissance ou d’inflation ou des taux d’emprunt très divergents, auxquels une politique monétaire unique rend impossible de répondre par des politiques diversifiées, adaptées à chaque cas, la zone euro n’est pas du tout une zone monétaire optimale. Or l’absence d’union budgétaire significative (le budget de l’UE pèse 1 à 2% du PIB européen, alors qu’aux États-Unis, le budget de l’Etat fédéral pèse 20 à 25% du PIB américain) empêche de pallier ces faiblesses par des transferts budgétaires… Ce qui fait de la zone euro une zone de compétition maximale au sein de la mondialisation bien plus qu’une zone de coopération : en lutte les uns contre les autres pour attirer les capitaux (en régime de libre circulation des capitaux) et écouler leur production (en régime de libre-échange), les États membres, les régions, les entreprises et les travailleurs se livrent à une course perpétuelle au moins-disant fiscal, social ou environnemental. Il faudrait donc, pour créer une cohésion interne, renforcer drastiquement l’union sur le plan budgétaire mais également sur bien des plans règlementaires comme la définition d’un salaire minimal, de normes de protection sociale, des normes de prélèvements sociaux et fiscaux en plus de déployer la monnaie volontaire pour financer conjointement la bifurcation écologique et sociale.
2) D’autre part, l’euro était un projet d’affirmation de l’Union européenne comme puissance géopolitique ayant une monnaie internationale, destinée à concurrencer le dollar dans les échanges mondiaux et comme monnaie de réserve – ce que l’euro n’a que très partiellement réussi à faire … L’avenir est de toute manière très incertain en matière de rapports de force politiques, avec la montée des BRICS et l’amorce d’une dédollarisation. L’Europe a-t-elle encore une alternative à proposer au monde face à l’hyper-capitalisme américain et à la dictature chinoise ? La monnaie volontaire serait un moyen pour elle de prendre le leadership dans la construction d’un nouveau modèle de développement apte à relever les défis majeurs (écologiques et sociaux) de notre époque.
Le 23 février 2024

Mots-clés
Biens publics mondiauxgéopolitique
crise
« mondialisation heureuse et froide »
géoéconomie
Institutions
Questions de « sens »
mondialisation
Technologies
Société
France
Europe
gouvernance
HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
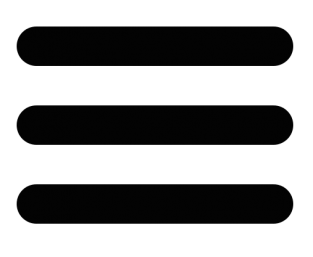

 GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
 LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER
LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER