HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
DE LA SOCIÉTÉ POST-INDUSTRIELLE À LA SOCIÉTÉ HYPER-INDUSTRIELLE. LA RÉHABILITATION DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE. Par Arnaud PAUTET
mercredi 26 janvier 2022 Arnaud PAUTET
On lira avec grand intérêt ce très bel article d’Arnaud Pautet (1). L’auteur combine une triple approche : historique, économique et géopolitique. « Le retour actuel du national » apparaît comme une réponse aux dérives de la société tertiaire hyper-industrielle et hyper-connectée. Voilà plusieurs décennies que « les élites pensaient » la disparition de la société industrielle, au profit d’une civilisation du savoir et du diplôme - approche poussée plus récemment jusqu’au fétichisme de la dématérialisation numérique (aveuglement ? vanité ? cynisme ?). Une autre manière de lire cette croyance était d’affirmer « une prétendue fin de l’Histoire ». Aujourd’hui ces aveuglements ne résistent pas à un constat implacable : crise et rejet de l’universalisme occidental, retour de la géopolitique de puissance et de prédation, ruptures économiques et inégalités explosives. Le capitalisme démocratique est menacé à l’extérieur par les régimes autoritaires. Il est désormais mis en échec à l’intérieur par la ploutocratie et le techno-féodalisme, voire par un capitalisme de surveillance.
Ne nous trompons pas : il s’agit bien là d’une lecture historique et structurelle sur l’outil industriel, qui est passé d’une certaine détestation au mythe d’une tertiarisation heureuse, puis aux nouvelles peurs de soulèvements sociaux multiples, sans oublier le plan géopolitique avec le risque d’un basculement de puissances. La pandémie a accentué le renversement de perspective, redorant le blason des identités et de la souveraineté économique. La question des industries stratégiques est posée, au delà celle du rôle de l’Etat et des biens communs... C’est d’une redéfinition d’« une souveraineté raisonnable », dont il s’agit dans le cadre des interdépendances de la globalisation.
Le temps présent est à l’évidence un moment historique sur le fil du rasoir, dont les multiples enjeux sont analysés par l’auteur et de nombreux textes de GeopoWeb. P.L
(1) Arnaud Pautet est Agrégé et Docteur en histoire contemporaine de l’Université d’Aix-Marseille (UMR Telemme). Il enseigne l’économie, l’histoire et la géopolitique en classes préparatoires.

DE LA SOCIÉTÉ POST-INDUSTRIELLE À LA SOCIÉTÉ HYPER-INDUSTRIELLE. LA RÉHABILITATION DE LA SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE
Partout dans le monde occidental, la peur de la désindustrialisation fait écho à un sentiment de déclassement par rapport au monde émergent et singulièrement lorsque l’Occident se compare au colosse chinois. Alors qu’il avait semblé légitime aux décideurs économiques et politiques des vieilles puissances industrielles de se passer d’une bonne partie de leur outil de production depuis les années 1960, les années 2010 et la pandémie actuelle ont ravivé un désir de souveraineté économique, et cette souveraineté passerait par le raccourcissement de la chaîne de valeur, des relocalisations d’usines et un protectionnisme sélectif, pour sanctuariser ses industries stratégiques.
La tertiarisation semble avoir déçu : même si les services emploient plus des deux tiers des actifs et créent plus des deux tiers de la valeur ajoutée des nations « postindustrielles », ils ne permettent pas de renouer avec une forte productivité des facteurs de production (PGF) et une croissance équilibrée de long terme. La peur d’une « stagnation séculaire » popularisée par les économistes Robert Gordon ou Larry Summers rappelle à quel point la révolution numérique n’a pas été, pour l’instant, l’équivalent de l’électricité au XXe siècle, ou de la vapeur au XIXe [1]. Plateformes et start-up digitales ne semblent pas avoir cassé les chaînes qui entravent la création de valeur. L’industrie mondiale, encore largement carbonée, de plus en plus robotisée, continue de générer l’essentiel des gains de productivité, tout en représentant une part stable de la population active mondiale depuis deux siècles (environ 4%).
En France, le rapport Gallois (2012) semble avoir été une rupture dans l’esprit des décideurs : la souveraineté économique a cessé d’être un mot tabou pour devenir un objectif de politique économique et même de géostratégie.
1. La société tertiaire avancée : la « société postindustrielle » (Daniel Bell, Alain Touraine), un dangereux mythe ?
L’idée que l’on se fait de la « société postindustrielle » est souvent tronquée et il est nécessaire de revenir aux sources de ce concept. Il apparaît en réalité dès 1914, sous la plume d’un historien de l’art et philosophe, Ananda Coomaraswamy, né au Sri Lanka, et d’un théoricien du socialisme anglais, Arthur Penty. Dans leur essai commun Essais in Post-Industrialism : A Sympasium of Prophecy concerning the Future of Society, ils imaginent une société où la technique est mise au service du bien-être de l’humanité, s’opposant à « la division du travail et à l’utilisation illimitée des machines qui conduisent notre civilisation à sa perte ». Il s’agit donc d’une réaction à l’industrialisation à outrance qui va culminer justement dans la destruction de masse des combattants sur les fronts de la Grande Guerre, et non d’une déification de la fée industrie au nom d’une idéologie scientiste.
Dans les années 1960, le sociologue français Alain Touraine, fin connaisseur des usines Renault, réfléchit à son tour sur le concept. Il observe une société distincte de la civilisation industrielle et cherche à comprendre comment elle pourrait se transformer. Il abandonne rapidement dans son ouvrage (La société postindustrielle. Naissance d’une société, 1969) le terme postindustriel pour décrire l’avènement de « sociétés technocratiques si l’on cherche à les définir d’abord par qui les domine » ou de « sociétés programmées si on cherche à les définir d’abord par la nature de leur mode de production et d’organisation économique ». Il pressent donc la substitution des experts, des technocrates, aux représentants politiques et aux patrons. L’économie se désencastre du politique, n’est plus régie par lui mais le domine, et investit le reste de la société, et la culture. Il entrevoit également un mouvement de résistance à cette nouvelle classe dominante, « s’identifiant au progrès », sur la base d’une « conte-utopie rejetant en bloc la société de consommation ou les contraintes organisationnelles de production ». La société postindustrielle s’ancre pour lui dans cette recherche d’une alternative, elle manifeste le désir de s’extraire de la civilisation industrielle. Il prend ainsi ses distances avec la doxa d’une société parvenue à un tel niveau de productivité qu’elle pourrait se détourner de la production pour se concentrer sur la consommation et les loisirs. Alain Touraine est alors en bonne compagnie, si l’on songe à la parution, dans une séquence courte, de La société de consommation (1970) de Jean Baudrillard, et de La société du spectacle (1967) de Guy Debord.
Pour ce dernier, la société tertiaire avancée produit de nouvelles formes d’aliénation dans un monde où le réel s’éclipse derrière ses représentations : « l’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (…) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. » Le fondement de cette nouvelle ère du capitalisme que représente la société du spectacle est la transformation des loisirs des travailleurs en marché. Une pensée qui rapproche Debord et les situationnistes de la philosophe Hannah Arezndt dans La crise de la culture (1961) : « la société de masse (…) ne veut pas la culture, mais le divertissement, (…) et les articles offerts par l’industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. (…) Ils servent, comme on dit, à passer le temps, et le temps vide qui est ainsi passé n’est pas, à proprement parler, le temps de l’oisiveté (…). Et la vie biologique est toujours, au travail comme au repos, (…) un métabolisme qui se nourrit des choses en les dévorant ». Surtout, Debord confirme les prédictions de Theodor Adorno et Max Horheimer (Kulturindustrie. Raison et mystification des masses, 1947, publié en français en 2012) sur le renversement de la figure de l’ouvrier dans le modèle capitaliste : « dans le capitalisme avancé, l’amusement est le prolongement du travail. Il est recherché par celui qui veut échapper au processus de travail automatisé pour être de nouveau en mesure de l’affronter ». Il apparaît comme un expédient inventé par le capitaliste pour permettre au prolétaire de reconstituer sa force de travail en exploitant ce temps « mort » pour faire malgré tout du profit. Une idée développée également par Alain Touraine pour qualifier le fantasme d’une société dématérialisée, réconciliant dominants et dominés. Le tout repose naturellement sur un rapport compulsif à la consommation, un culte de l’accumulation ; ainsi que l’explique Jean Baudrillard, la société de consommation a « fait disparaître de manière quasi-magique la rareté ». L’abondance est la condition de la consommation permanente, les individus ne pouvant jamais être satisfaits, comblés, y compris dans leurs loisirs. La croissance ne peut être pérenne que si l’individu refuse la frugalité, et la frustration qu’elle induit.
Au fil du temps le concept de société postindustrielle s’est affadi. Il a été présenté comme un nécessaire glissement dialectique d’une société industrielle à une société tertiaire, du fait de l’essor des nouveaux pays industrialisés et des incitations à délocaliser les activités à faible valeur ajoutée pour profiter des différenciels de coût de main d’œuvre. Il fallait alors aux vieilles puissances industrielles se concentrer sur la production à grande échelle de cerveaux qualifiés et diplômés, des « cols blancs » appelés à se substituer aux « cols bleus » qui avaient bâti de leurs main la civilisation industrielle, en espérant que la magie du « déversement » (Alfred Sauvy) continue à opérer. Les meilleurs experts constataient que nos vieilles puissances ne pouvaient plus rivaliser avec les nouveaux pays industriels. Rappelons qu’en 1969, Robert Guillain publiait Le Japon, troisième grand, faisant du pays du Soleil Levant la grande puissance industrielle de l’avenir, quand celui-ci sortait auréolé d’un « âge d’or » (Angus Maddison) de la croissance à 8% du PIB par habitant ; qu’en 1975, les prospectivistes prédisaient au Brésil, aux mains d’une dictature militaire jugée « progressiste », le destin de troisième puissance mondiale à l’horizon 2000 (un « miracle brésilien » qui faisait des émules, comme le Mexique dont le PIB équivalait alors à dix fois celui de la Chine). Pour Alain Touraine, comme pour ces penseurs critiques, la société postindustrielle était tout autre chose.
Au début des années 1970, le concept est clarifié par le sociologue américain Daniel Bell (Vers la société postindustrielle, 1973). Citant Whitehead, Bell explique que l’inventeur débrouillard est renvoyé au musée et que la civilisation industrielle s’éclipse devant une civilisation du savoir et du diplôme. Il prédit une substitution du « complexe scientifique administratif » au complexe militaro-industriel évoqué par Eisenhower (1954) et dépose le pouvoir dans les mains de « tandems » (universitaire-industriel, universitaire-militaire et universitaire-étatique). Il note que « l’ensemble des industries nouvelles des années 1970 sont intégralement fondées sur la science ». Le développement de la recherche et développement dans les Big Pharma, l’avènement des biotechnologies et nanotechnologies, au-delà du seul secteur des technologies de l’information et de la communication, semblent lui avoir donné raison. Par ailleurs, Bell s’intéresse aux mutations de l’entreprise et anticipe les théories des parties prenantes énoncées la décennie suivante, en dissociant l’entreprise privée (projet collectif) et la propriété privée (les titres financiers détenus par les actionnaires) : « les vrais propriétaires d’une entreprise sont ceux qui sont et qui se sont liés à son sort : dans le cas des sociétés par actions, les membres du personnel répondent à cette description mieux que les actionnaires ». Ces éléments de prospective, avec le recul, paraissent difficilement contestables.
2. De la société « postindustrielle » à la société « hyperindustrielle » (Pierre Veltz) : le mythe s’évanouit
En 2006, dans ses Trois leçons sur la société postindustrielle, Daniel Cohen prenait déjà quelques distances avec un concept qui enfermait la réflexion dans cette dialectique de la tertiarisation comme fin de l’histoire. Il analysait cependant une autre facette de cette société postindustrielle, la financiarisation accentuée de l’entreprise, pilotée par une gouvernance actionnariale coupable selon lui d’avoir « arraché le manager au salariat [2] » en faisant dépendre sa rémunération essentiellement des titres financiers de son entreprise (stock-options et autres retraites-chapeaux). Un retour en force de la « propriété privée », au détriment des parties prenantes, avec des experts dorénavant mandatés pour améliorer la performance financière de l’entreprise et le retour sur investissement des épargnants. On entrait dans l’ère des qualitativistes, passés maîtres dans la réalisation et surtout l’évaluation de process pour optimiser la chaîne de valeur mondiale en profitant des opportunités ouvertes par la révolution numérique.
L’affaiblissement du concept tenait aussi à l’évolution de la situation des pays émergents qui subissaient plus qu’ils ne désiraient cette tertiarisation accélérée. A l’exception notable d’une Chine hégémonique dans un nombre croissant de productions manufacturières, les anciens NPI étaient entrés dans une phase de turbulence, pour la plupart en proie à une « désindustrialisation prématurée » (Dani Rodrik, notamment dans La mondialisation sur la sellette, 2018). L’échec des stratégies développementalistes de substitutions d’importations (Argentine, Mexique) dans les années 1970 avait révélé l’insuffisance de classes moyennes aisées capables de consommer les biens manufacturés produits par les filières nationales sud-américaines. L’inflation et l’endettement considérables avaient acculé certains États à la banqueroute après le relèvement en 1979 des taux d’intérêt directeurs par la Federal Reserve (banqueroute de 1982 pour le Mexique). Les économistes néo-libéraux régnant en maîtres à la Banque Mondiale, au Fonds Monétaire International et au département du Trésor américain proposèrent des « thérapies de choc [3] » aux pays en crise pour avoir accès à nouveau à des financements (programmes d’ajustement structurel), notamment avec les plans Baker (1985) et Brady (1989). La croissance revint, l’inflation fut muselée, mais l’endettement continua de se creuser et les inégalités se renforcèrent par l’affaiblissement des budgets dédiés dans ces États à la santé et à l’éducation. Soumises à la concurrence mondiale, les industries émergentes se délitèrent rapidement. Dès le milieu des années 1980, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, atteignent le pic de l’ouvriérisation, puis se désindustrialisaient, alors même que l’industrie n’avait pas encore procuré aux travailleurs des niveaux de revenus comparables à ceux des travailleurs occidentaux pendant les Trente glorieuses. À la fin des années 1970, 40% de la valeur ajoutée du Brésil était d’origine industrielle ; aujourd’hui, guère plus de 15%. La plupart de ces pays émergents étaient victimes du « syndrome argentin » décrit par Céline Antonin, Philippe Aghion et Simon Bunel (Le pouvoir de la destruction créatrice, 2020). Leurs fragilités, notamment l’inefficacité de leurs institutions, les ont empêchés de se rapprocher de la frontière technologique, de passer d’une stratégie de développement fondée sur l’imitation à une autre fondée sur l’innovation.
Pour sortir de l’impasse de cette société postindustrielle qui n’en est pas une (jamais les êtres humains n’ont produit et utilisé autant d’objets manufacturés), Pierre Veltz forge le concept de société « hyperindustrielle » (La société hyperindustrielle, 2017). Il prend ses distances avec la désindustrialisation et préfère mettre en exergue une révolution : le passage d’une société de la possession (propriété) à une société de l’usage (accès). La possession d’un bien n’est plus recherchée pour elle-même, mais pour les services auxquels ce bien donne accès. Il parle de « société servicielle » pour décrire cette nouvelle civilisation où les biens d’usine permettent de consommer des services. Ainsi, le smartphone sert moins à téléphoner qu’à surfer sur internet, à télécharger des applications, à consommer des vidéos. L’évolution des publicités consacrées aux voitures donne la mesure de cette révolution : la voiture n’est plus un moyen de transport autonome ou la matérialisation d’une réussite sociale, elle est un outil parmi d’autre de la mobilité et un média vers des services (musique, navigation, etc.). De même le développement du leasing traduit un détachement de ce désir de possession, et les publicités ne dévoilent plus le prix réel de l’objet, mais les mensualités de remboursement d’un prêt ou d’une location. Comme le rappelait le PDG de BMW, « la mobilité est un besoin humain, pas la voiture ». Tous les secteurs ont été touchés par cette vision « servicielle ». Ainsi, l’industrie nucléaire française s’est peu à peu détournée de la production de réacteurs pour se concentrer sur le service après-vente de ces centrales auprès des pays auxquels avaient été vendus dans le passé des réacteurs. Une stratégie aujourd’hui contestée, car elle a conduit à la disparition de compétences (les chaudronniers capables de faire des soudures spécifiques pour les cuves nucléaires), difficiles à renouveler, alors même que l’industrie nucléaire semble dépassée par ses rivaux dans la compétition pour les petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactors) et les travaux prometteurs sur la « fusion » nucléaire (permettant de s’affranchir des combustibles et donc de leur retraitement).
La société postindustrielle n’a pas non plus tenu ses promesses en matière de « dématérialisation ». Le rêve écologique de sociétés débarrassées des pollutions industrielles résiste mal à la réalité : l’industrie numérique, après le passage à la 5G, produira sans doute plus de GES que le trafic aérien mondial ; elle requiert des métaux rares et faiblement radioactifs qui conduisent à des naufrages écologiques, ainsi que l’a montré Guillaume Pitron (La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, 2018). Les déserts radioactifs se multiplient en Chine autour des mines rapidement exploitées, et laissent craindre une crise écologique majeure et préjudiciable au développement durable du pays. Pour obtenir quelques grammes de ces précieux inputs industriels, il faut dynamiter des tonnes de roches, utiliser des dizaines de mètres cube d’eau, et polluer durablement des régions entières impropres à la culture et à l’habitation. Le développement des objectifs de RSE (responsabilité sociétale et environnementale des entreprises) rencontre certes les aspirations de consommateurs à la conscience écologique plus aiguë, mais les entreprises peinent à dépasser le stade du greenwashing. Si en 2018 Blackrock incitait officiellement ses clients à investir dans des produits durables jugés plus rentables, en 2021 plusieurs cadres de haut niveau du fonds d’investissement ont démissionné avec fracas pour dénoncer de simples effets d’annonce. Même si les plateformes numériques offrent l’opportunité de rallonger la durée de vie des objets (Vinted, Backmarket), même si les smart grids permettent de prévenir l’usure des infrastructures (UBS) et d’optimiser la production et la consommation d’énergie (compteurs Linky), on aurait tort de célébrer l’avènement d’une civilisation écologique. L’essentiel de l’énergie consommée, fait nouveau, ne l’est plus au cours de la période d’utilisation de l’objet, mais lors de sa conception (l’énergie dite « grise »).
Le passage à un mode de production industriel soutenable requiert enfin une indemnisation des nombreux perdants de la transition. Or l’état des finances publiques ne semble pas le permettre, d’autant que les politiques se montrent souvent pusillanimes, autant face aux lobbies industriels désireux de préserver leur position, que face à leurs électeurs hostiles aux taxes écologiques. La crise de la Covid n’a rien arrangé, la mutualisation du financement de la crise ayant aggravé déficit et dette publics. Une seule solution alors selon l’économiste de l’OFCE Éloi Laurent (L’impasse collaborative, 2018), décélérer la révolution numérique pour accélérer la révolution écologique, et miser sur une économie de la coopération mettant au centre l’intelligence collective.
3. Le retour au nationalisme industriel et à la souveraineté économique au « temps des prédateurs » (François Heisbourg)
Les événements du début du XXIe siècle ont étrillé nombre de certitudes libérales et démocratiques, et amènent à repenser radicalement notre logiciel. La croyance en une « fin de l’Histoire » s’est évanouie entre 2001 et 2008. Les attentats du 11 septembre 2001 ont confronté le cosmopolitisme occidental aux identités réfractaires à l’universalisme. Les sociétés occidentales sécularisées ont été bousculées par le retour du religieux, qu’il s’agisse de l’évangélisme puissant sur le continent américain (États-Unis, Brésil), du péril djihadiste incarné par les mouvances affiliées à Al Qaïda puis à Daesh (enkystées dans un terrorisme nihiliste et destructeur), ou de l’hindouisme intransigeant (qui crée en Inde un « national-populisme et une démocratie ethnique » inquiétants [4]). L’universalisme a également buté sur l’affirmation croissante du droit à la différence, souvent conjugué à un désir de dédommagement des minorités ostracisées ou blessées par le passé. La crise des subprime a fait le reste, remettant au premier plan l’inégalité mondiale et faisant prendre conscience de la schizophrénie d’un capitalisme néo-libéral privatisant les gains et mutualisant les pertes. L’identité nationale fut donc doublement attaquée : par une identité globale construite par les grandes firmes culturelles (Hollywood, GAFAM, CNN…) oeuvrant à la « dysneylandisation du monde » (Jean-Pierre Warnier) et à l’édification d’une « société liquide [5] » (Zyngmunt Baumann) d’une part ; par le rejeu des identités assoupies (confessionnelles, de genre, familiales), communautaires, souvent blessées et militantes, d’autre part.
Une manifestation du rouleau-compresseur de la globalisation a été, dans la première décennie du siècle, la substitution des relations « inter-sociales » aux relations internationales et géopolitiques, ainsi que l’explique Bertrand Badie (Vers un monde néo-national, 2017). Par les canaux du numérique et la connexion des réseaux intellectuels, elle a eu tendance à diffuser à l’échelle de la planète des thématiques globales : les inégalités, le changement climatique, l’évasion et l’optimisation fiscales, la vulnérabilité des femmes et des minorités, le droit des animaux, etc. La seconde décennie a vu au contraire un retour en force de la géopolitique : en réaction au cosmopolitisme d’une partie des élites, un modèle néo-national et populiste a pris de l’ampleur dans les démocraties autant que les « démocratures », aboutissant au retour de puissances agressives et prédatrices (Russie, Turquie, Chine) et à la victoire de régimes populistes dans des démocraties historiques (États-Unis, Brésil, Italie). Une dangereuse logique de bloc réapparaît, soit de nature économique (Regional Comprehensive Economic Partnership, dit RCEP, entré en vigueur le 1er janvier 2022 entre quinze pays de la zone pacifique), soit de nature militaire (gesticulations russes à la frontière ukrainienne pour répondre aux pressions de l’OTAN en Pologne et dans les États baltes ; alliance AUKUS en 2021 pour contrer la progression chinoise dans l’Indopacifique).
Ce retour du national apparaît comme une réponse aux dérives de la société tertiaire « hyperindustrielle » et hyperconnectée. Comme l’explique Cédric Durand, la convergence de la pensée libertaire née dans les années 1960 dans la Silicon Valley et de la pensée néoconservatrice apparue dans les hautes sphères de Washington (faucons démocrates et néoconservateurs républicains) a produit un « technoféodalisme » (Technoféodalisme, critique de l’économie numérique, 2020) réduisant les consommateurs connectés à un nouveau servage par les titans du numérique. Le retour des identités conflictuelles est conforté par des réseaux sociaux qui invitent au rapprochement entre pairs, aux phénomènes d’appariement sélectif, etc. La société « hyperindustrielle » fragilise le capitalisme libéral-méritocratique, ainsi que le rappelle Branko Milanovic. Elle a fait exploser les inégalités en fusionnant les plus hauts revenus et les plus gros patrimoines aux États-Unis notamment par l’endogamie des plus diplômés (phénomène qu’il qualifie d’homoploutia dans Le capitalisme sans rival, 2020), fait inédit dans l’histoire. Les 1% les plus riches aux États-Unis pesaient 11% du revenu national en 1980, ils pèsent 20% du revenu national aujourd’hui. Dans le même temps, les 50% les plus pauvres sont passés de 21% du revenu national à 13%. Le capitalisme devient ploutocratique : comme le rappellent Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, la vingtaine de candidats en lice aux primaires lors de l’élection présidentielle de 2016, dont la campagne coûtait plus d’un milliard de dollars, a été financée à plus de 50% par seulement 400 familles richissimes (Le triomphe de l’injustice, 2020). On comprend mieux alors la crainte d’un pouvoir inféodé aux intérêts particuliers, et surtout l’importante abstention des minorités lors de cette élection.
L’affaiblissement des classes moyennes et modestes n’était pas dû cependant qu’à l’accaparement du gâteau de la croissance par les nantis, aux États-Unis comme ailleurs. Il s’expliquait surtout par une compétition mondiale exacerbée, qui avait profité principalement à la Chine, aimant des délocalisations et des investissements directs à l’étranger depuis le grand tournant des « quatre modernisations » (1978-1984). Ce plébiscite pour Pékin a largement contribué à détruire l’emploi industriel occupé par ces catégories sociales. Depuis 2013, plusieurs études ont confirmé l’impact des importations chinoises sur la destruction de l’emploi industriel, notamment celles de David Autor, David Dorn et Gordon Hanson [6] dans le cas américain, et celle de Clément Malgouyres dans le cas français [7]. Les deux tissent un lien entre accroissement des importations chinoises, baisse relative des salaires et destruction d’emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis (de 1990 à 2007, causant 25% du déclin de l’emploi industriel) et en France (de 1995 à 2007, causant 13% du déclin de l’emploi industriel).
La peur d’une destruction de l’outil industriel devint alors une réalité dans l’esprit d’un nombre croissant de décideurs, alors qu’elle était auparavant présentée comme un « mythe » dans de nombreux rapports ministériels ou parlementaires (rapport Roustan de 2004). Le constat est pourtant sans appel selon François Bost et Dalila Messaoudi dans le cas français : entre 2004 et 2013, la production de véhicules particuliers fabriqués sur le sol français a chuté de 50%, la France chutant du 4e au 11e rang mondial. Les effectifs globaux de l’industrie française sont passés de 5,6 millions en 1970 à 3,3 millions en 2014, soit 52 200 emplois industriels détruits chaque année (notons qu’entre 1991 et 2010, la baisse en valeur relative a été assez proche en France, en Allemagne et au Japon). Quant à la contribution de l’industrie manufacturière au PIB, elle était de 10,8% en France en 2016 (contre 30,2% en Allemagne, 11% en Grande-Bretagne) alors qu’elle représentait 25% du PIB en 1960 [8]. Laurent Davezies nous invite cependant à relativiser l’ampleur de cette désindustrialisation : entre 1995 à 2015, notre production industrielle a doublé quand le nombre total d’heures de travail a été réduit de moitié (la productivité horaire a quadruplé). La part de l’industrie ne représente plus qu’un dixième du PIB, mais depuis 1960 le prix des produits industriels a décru très rapidement, libérant beaucoup de pouvoir d’achat pour des services dans lesquels l’Hexagone s’est spécialisé. Si l’on compare les valeurs ajoutées à prix constant, en volume, l’écart entre la France et l’Allemagne est resté stable depuis les années 1950. Si l’on inclut les services très industrialisés à cette valeur ajoutée strictement manufacturière (transport, eau, déchets, énergie, télécommunication), de 1975 à 2011, on revient à environ 30% du PIB total.
Quoiqu’il en soit, cette prise de conscience a redonné ses lettres de noblesse au concept de « souveraineté économique ». Les discours sur la relocalisation reflètent ainsi une cinétique plus profonde, celle d’un désir retrouvé pour l’État planificateur, boudé depuis trente ans par les décideurs lui préféraient un État réduit au rôle d’arbitre du jeu de la concurrence mondiale. L’État peut inciter les entreprises à choisir un territoire en déployant une politique raisonnée en matière de transport et d’énergie. Depuis 2018, 148 « territoires d’industrie » ont été créés, bénéficiant d’un engagement spécifique de l’État et des collectivités pour les aider à attirer des entreprises nationales et étrangères pour reconstruire un tissu industriel. Divers acteurs proposent des paniers de services aux entreprises, des outils d’accompagnement pour faciliter leur implantation dans les territoires. Les cas de relocalisation restent cependant relativement rares : Rossignol a rapatrié à Sallanches (Haute-Savoie) ses lignes de production délocalisées à Taïwan en 2007. Athéna a relocalisé à Aimargues et Sauve (Gard) ses lignes de production, auparavant délocalisées au Maghreb et en Égypte. Leurs principales motivations peuvent être la piètre qualité des produits conçus à l’étranger, la peur de l’espionnage et de la contrefaçon, du pillage des technologies par des concurrents, les défaillances de la chaîne logistique avec des délais d’approvisionnement ou de réassorts trop longs, le trop grand éloignement des marchés de consommation, etc.
On assiste à un renversement de perspective en France. Longtemps, les maires et élus régionaux cherchaient à attirer des entreprises en offrant des conditions favorables (bas prix du foncier, exemption de taxes locales, aides à l’installation, etc.). Aujourd’hui, les pouvoirs publics cherchent moins à attirer des entreprises que des travailleurs qualifiés, et jouent sur les aménités, la qualité de vie. Ils défendent ainsi la présence de services publics (écoles, hôpitaux), de commerces, de modes de garde, des loisirs particuliers etc. pour attirer des cadres supérieurs et revitaliser leur commune ou leur région. Ils s’adressent aussi aux investisseurs étrangers, en vantant la bonne connectivité de notre territoire, ainsi que le rappelle à nouveau Pierre Veltz (La France des territoires, défis et promesses, 2019) : pour un investisseur chinois, la France a la superficie d’une grosse agglomération chinoise, et l’on peut rallier en moins de 3 heures les différents sommets de l’hexagone, ce qui représente un atout considérable.
Le retour à la souveraineté économique n’implique cependant pas les mêmes efforts de la part de tous les États, car tous ne présentent pas le même degré de vulnérabilité aux industries étrangères : si l’on compare la part de la valeur ajoutée d’origine étrangère dans les produits manufacturés ensuite ré-exportés, on s’aperçoit que la France est très vulnérable (en moyenne 20% de la valeur ajoutée, notamment dans les biens d’équipement, les transports, l’industrie agro-alimentaire), les États-Unis beaucoup moins (environ 10%). Les pays occidentaux ont tardé à s’avouer le risque de maintenir des règles de concurrence ouvertes face à des puissances mercantiles, autoritaires et protectionnistes comme la Chine. La Commission européenne a ainsi empêché l’alliance de Siemens et Alstom pour constituer un « Airbus du rail » (2019), alors que cinq ans plus tôt les Chinois avaient créé un concurrent titanesque, CRRC, qui a construit en Chine en quinze ans 27 000 kms de rail (soit 15 fois le réseau TGV français). La Commission a sans doute pris conscience de son erreur, autorisant Alstom à racheter Bombardier Transport, constituant ainsi le numéro 2 mondial du ferroviaire (2021). Les États-Unis depuis 2017 nous alertaient pourtant sur la nécessité de hausser le ton face à Pékin : Washington avait empêché des IDE chinois dans les télécommunications (Huawei). En 2018, Donald Trump s’était opposé au rachat de Qualcomm, premier producteur mondial de puces 4G, par Broadcom, faux nez singapourien de firmes chinoises. En 2019, il avait aussi refusé que la firme de paiements électroniques Moneygram soit conquise par le géant chinois de l’e-commerce Alibaba. L’imposition de taxes massives par l’ancien locataire de la Maison Blanche scellait le retour à la guerre économique. Ces taxes protectionnistes visèrent d’abord les fournisseurs de produits métallurgiques de base (25% sur l’acier, 10% sur l’aluminium) avant de s’élargir à tous les secteurs (visant notamment le vin français en bouteille dont les ventes devaient s’écrouler aux États-Unis de près de 25% en 2020). L’administration de Joe Biden lève graduellement ces entraves (comme d’ailleurs Donald Trump pendant les derniers mois de sa présidence) pour amorcer une désescalade avec le rival chinois.
La pandémie a diffusé dans l’opinion publique ce besoin d’indépendance et de souveraineté économique. Les files d’attente devant les supermarchés révèlent que l’interdépendance peut brutalement devenir une source de dépendance : l’externalisation de la production de médicaments, de masques, de gel hydro-alcoolique, de papier hygiénique, longtemps défendue dans une logique d’optimisation des coûts, devenait la raison de pénuries et de hausses brutales des prix. Un simple virus pouvait casser la cinétique mondiale jugée infaillible depuis quarante ans. Le raccourcissement des chaînes de valeur, jusqu’alors plébiscité pour des raisons écologiques (réduire les transports longue distance, produire local, retraiter ses déchets plutôt que les outsourcer), était maintenant défendu pour des raisons stratégiques (avoir son destin et sa sécurité nationale en main).
Si le désir d’indépendance est plus que jamais légitimedans un environnement résolument hostile, parfois ces postures s’avèrent cependant dangereuses, crispent les relations y compris entre les alliés. L’usage de l’extraterritorialité se banalise, aussi bien dans la sphère économique (interdiction d’exporter des avions de chasse fabriqués en Europe parce qu’ils contiennent des composants américains, interdiction de commercer avec des ennemis des États-Unis sous peine de lourdes sanctions financières, subies par exemple par Lafarge ou la Société Générale), que dans le domaine militaire (accoutumance américaine aux exécutions ciblées par drones Reaper au Yémen, dans la corne de l’Afrique, dans le Sahel, au Moyen-Orient). Elles entremêlent dangereusement pressions économiques et militaires (quand en 2015 la Chine sanctionne économiquement les Philippines pour avoir porté devant la Cour de la Haye la question de la souveraineté des îlots disputés de mer de Chine méridionale).
La « société hyperindustrielle », pour l’heure, n’a donc pas conduit à l’avènement d’un monde pacifié par le libre-échange et conquis par la démocratie de marché. Elle a au contraire fait émerger un national capitalisme autoritaire (Ahmet Insel et Pierre-Yves Hénin, Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, 2021) qui préconise l’affaiblissement des libertés individuelles et de la délibération démocratique pour rendre le capitalisme plus efficient. Longtemps, les noces de la démocratie et du capitalisme avaient paru les plus fécondes pour la croissance économique et le développement. A la suite d’Amartya Sen, la démocratie semblait avoir un avantage sur les dictatures, parce que la circulation libre de l’information et la lutte contre la corruption étaient propices à l’innovation. La seconde décennie du XXIe siècle nous invite à tempérer cet optimisme. Au Brésil, en Turquie, en Russie, en Chine, le capitalisme de la peur s’accommode très bien d’un pouvoir illibéral. Les crises en chaîne du début du XXIe siècle ont arc-bouté les États sur une conception ancienne de la « sécurité nationale », les empêchant de bâtir dans les instances multilatérales une « sécurité internationale » (Bertrand Badie, Les Puissances mondialisées. Repenser la sécurité internationale, 2021), seule capable de répondre aux défis globaux qui se posent à nous. Le politologue nous invite à moderniser le concept de souveraineté pour le rendre compatible avec les interdépendances de la globalisation.
Arnaud Pautet, le 20 janvier 2022

Mots-clés
« mondialisation heureuse et froide »Conditions de travail
économie et histoire
géoéconomie
géopolitique
souveraineté
guerre économique
Industrie
mondialisation
Questions de « sens »
Relations internationales
puissance
Asie
Chine
Etats-Unis
Europe
France
Japon
Notes
[1] Sur cette question on conseillera Antonin BERGEAUD, Gilbert CETTE, Rémy LECAT, Le bel avenir de la croissance, Odile Jacob, 2018.
[2] Sur l’impact des « théories de l’agence » auxquelles est adossée cette révolution de la shareholder value (valeur pour l’actionnaire, voir Armand HATCHUEL et Blanche SÉGRESTIN, Refonder l’entreprise, Seuil, 2012.
[3] Voir par exemple la remarquable analyse de ces « chocs sans thérapie » dans le cas de la Russie, sous la plume de Julien VERCUEIL, Économie politique de la Russie, 1918-2018, Seuil, 2019.
[4] Voir sur ce point Christophe JAFFRELOT, L’Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique, Fayard, 2019.
[5] Une société transformant immédiatement le neuf en vieux, dévitalisant les institutions et la notion d’engagement, au prétexte d’un culte permanent de la nouveauté, symbole de progrès. Pour Baumann, il s’agit du stade ultime de l’individualisme.
[6] « The China syndrome : Local labor market effects of import competition in the United States », in American Economic Review, vol. 103, n° 6, 2013.
[7] « The Impact of Chinese Import Competition on the Local Structure of Employment and Wages : Evidence from France » ; document de travail de la Banque de France n°603, septembre 2016.
[8] Arnaud PAUTET, « les stratégies de localisation des entreprises », in Raymond WOESSNER, Populations, peuplement et territoires en France, Atlande, 2022.
HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
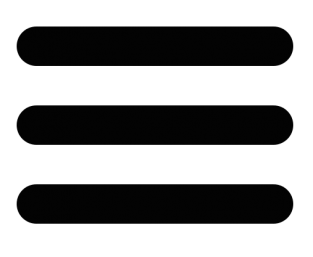



 LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER
LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER