HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
mardi 18 mai 2021 Baptiste RAPPIN
L’auteur, avec une belle mise en perspective analytique et intellectuellement stimulante, nous conduit vers les confins un peu oubliés du management. Baptiste Rappin (1) en dévoilant les postulats philosophiques des fondateurs des « sciences de l’organisation » (Taylor, Mayo etc...), nous rappelle le sens profond de leur doctrine : pacifisme et coopération, dépassant la raison d’être initiale des actions de rationalisation. La notion de puissance est absente de la théorie des organisations. F. W. Taylor rejette l’antagonisme comme moteur de l’Histoire (cf Marx). On lira avec (presque) étonnement la vision de cet ingénieur qui - s’il s’attache à la hausse des rendements - promeut un « management de proximité », les hommes allant jusqu’à se toucher dans leur tâche productive.
C’est une utopie de la coopération et un combat contre l’homo oeconomicus, qui rejetterait ainsi la logique des intérêts des uns et des autres (en particulier par la hausse des rémunérations). « Harmony, not discord. Coopération not individualism ».
On lira avec grand intérêt le passage de l’analyse organisationnelle à celle des nations belligérantes, l’opposition des régimes politiques, le rôle de l’information, qui nous conduiront à retrouver la notion de soft power et... l’Amérique comme berceau du géo-management.
On ne sera pas surpris, à partir de cette lecture profonde, de rejoindre la dimension cognitive, qui détermine largement aujourd’hui la hiérarchie des puissances.
🔎 A lire : Abécédaire de la déconstruction . Les carrefours de l’être. (collection dirigée par Baptiste Rappin). LESEDITIONSOVADIA, 28 Mars 2021
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT
Résumé : Beaucoup conçoivent le management comme un ensemble de techniques fondées scientifiquement qui visent à optimiser le fonctionnement des organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations, de collectivités, etc. Et quand les voix critiques se font entendre, elles demeurent au fond très largement ancrées dans cette perspective intra-organisationnelle. Pourtant, l’examen des postulats philosophiques des fondateurs du management met en évidence le sens même de cette doctrine : le pacifisme et la coopération, au sein de l’organisation certes, mais à un niveau mondial de façon plus générale. Il convient alors de prendre en considération que ce projet utopique constitue une arme géopolitique américaine de premier ordre.
L’absence de la géopolitique dans les sciences de l’organisation
Nous souhaiterions aborder, dans le présent article, un aspect du management largement passé sous silence aussi bien par la communauté des sciences de gestion en France et des organization studies à l’étranger que par celle des géopolitologues : sa dimension proprement géopolitique. Et loin de limiter cette appréhension à la manière conséquentialiste, c’est-à-dire en considérant le management dans ses effets géopolitiques, nous privilégions une piste de réflexion de nature résolument philosophique : en quoi le projet managérial, dans son essence même, dans sa propre substance, comporte-t-il une composante intrinsèquement géopolitique ? Plus avant, et plus radicalement : dans quelle mesure faut-il considérer le management comme une arme géopolitique américaine participant de la guerre cognitive et culturelle en cours ?
La discipline appelée « théorie des organisations » regroupe le corpus conceptuel du management. Logique, car si l’on parle de « sciences de gestion » en France, dénomination institutionnelle, les pays anglo-saxons parlent quant à eux d’ « études organisationnelles » ou encore de « science des organisations ». Or, voici le constat que l’on peut très rapidement dresser : en ouvrant un manuel de référence de théorie des organisations, celui très complet de Jacques Rojot (2003), l’on ne trouve aucune trace de la géopolitique alors même que la sociologie, l’économie et la psychologie se trouvent très largement convoquées et mobilisées. Non seulement le terme n’apparaît-il pas dans la table des matières ni dans l’index thématique, mais encore aucun courant théorique présenté n’y fait-il référence. Par ailleurs, dans un ouvrage plus récent qui fait le point sur les « nouveaux tournants » en théories des organisations (de Vaujany, Hussenot et Chanlat, 2016), aucune place n’est ménagée à la géopolitique à côté des théories du processus, du tournant pratique, de l’approche socio-matérielle et de la montée en puissance des considérations sociétales. Enfin, l’on ne trouvera toujours pas notre bonheur en consultant un ouvrage de synthèse sur les théories critiques (Critical Management Studies) dans lequel le lecteur découvrira des études faisant appel au marxisme ou au néo-marxisme, s’appuyant sur les différents auteurs postmodernes ou convoquant encore la sociologie critique (Golsorkhi, Huault et Leca, 2009). Au total, il semble bien que la notion de puissance soit tout à fait étrangère à la théorie des organisations, et que la géopolitique ne soit pas une approche pertinente des études managériales qui se préoccupent plus du fonctionnement organisationnel que de ses possibles répercussions géopolitiques.

La coopération ou la philosophie politique du management
Pourtant, un retour aux textes des fondateurs tend à prouver que cette dimension géopolitique ne saurait être séparée de la nature même du management. Partons alors de la formule suivante qui résume parfaitement l’esprit des Principes du Management Scientifique de Taylor : « Harmony, not discord. Cooperation, not individualism » (Taylor, 1998, p. 74). Le taylorisme s’oppose tout d’abord vivement à toutes formes de discorde, de mésentente, de lutte ; il ne peut faire sienne la lecture du monde qui érige l’antagonisme et la négativité en moteurs de l’histoire, notamment dans la pensée de Marx au sein de laquelle la lutte des classes oppose inlassablement les oppresseurs et les opprimés jusqu’à ce que les seconds triomphent définitivement des premiers. Dans ce cadre, le bonheur des uns s’obtient nécessairement au détriment des autres. Sans conteste, « scientific management will mean, for the employers and the workmen who adopt it, the elimination of almost all causes for dispute and disagreement between them » (Taylor, 1998, p. 75). Pour quelles raisons ? La première que Taylor avance n’est autre que l’augmentation des rémunérations car, grâce à elle, les revendications salariales ne se justifieront plus et n’auront donc plus cours ; mais surtout, « more than all other causes, the close intimate cooperation, the constant personnel contact between the two sides, will tend to diminish friction and discontent » (Taylor, 1998, p. 75). Sourd ici un aspect méconnu et pourtant essentiel de la doctrine taylorienne : on la prend pour un rationalisme froid, on la décrit encore comme un mécanicisme sans âme, mais on omet de préciser que la réussite d’une telle machinerie repose sur un « management de proximité », expression certes anachronique mais qui rend si bien compte du rôle clef de ces contremaîtres dont la mission ne consiste pas à surveiller les ouvrier mais à les guider et à les aider : « these men […] are the expert teachers, who are at all times in the shop, helping and directing the workmen » (Taylor, 1998, p. 64-65). Contre toute espèce de conflit, Taylor joue la carte de l’intimité, de la présence proche, du contact. De plus, le management scientifique s’oppose tout aussi intensément à l’individualisme, c’est-à-dire à toute doctrine qui prend l’individu, ses choix, ses préférences, ses intérêts, comme fondements de l’agir. En cela, le taylorisme combat d’une part le règne de la bourgeoisie, qui prend la forme de l’accumulation et de la confiscation du capital au profit de quelques-uns, et d’autre part l’économie néoclassique et sa figure abstraite de l’homo œconomicus. Mais il prend également ses distances avec la philosophie politique moderne qui, avec Machiavel et Hobbes, développe une anthropologie du désir individuel qui ne peut que mener à de dangereuses impasses : le conflit perpétuel des intérêts, l’obsession du pouvoir, la société pensée comme un contrat, la création d’un monstre (le Léviathan) au pouvoir absolu. C’est ainsi qu’il faut comprendre le slogan « Harmony, not discord. Cooperation, not individualism » : la science établit que les intérêts des employeurs et des travailleurs convergent, toute discorde est infondée en droit car elle ne s’appuie sur aucune revendication légitime.
Ce retour aux origines tayloriennes ne saurait en aucun cas relever de l’accessoire ou de l’anecdotique, mais constitue bien au contraire un puissant leitmotiv de l’histoire du management. C’est ainsi que Chester Barnard (1949, p. 5) partage le souci de Taylor : « I am not making a plea for « individualism » as opposed to « collectivism ». The extreme emphasis upon the individual in doctrinaire argument against various aspects of collective interest and action seems to me even less realistic than the reverse emphasis upon organization and collectivism ». C’est la raison pour laquelle le président de la Fondation Rockefeller peut ajouter qu’ « I am attempting to advocate neither an economic nor a social theory » (Barnard, 1949, p. 16). Tout comme Taylor, Barnard oppose la défense des intérêts, qu’ils prennent la forme de la revendication individuelle ou de la négociation collective (bargaining) à « la volonté de collaborer » (Barnard, 1949, p. 9) et à « l’attitude coopérative » (Barnard, 1949, p. 21). Force est bien de constater qu’Elton Mayo s’inscrit pleinement et explicitement dans le projet industrialiste : « Effective co-operation is the problem we face in the middle period of the twentieth century » (Mayo, 1975, p. li). Et en effet, outre l’accroissement du nombre d’individus malheureux, le psychologue, s’appuyant en la matière sur les sociologues Frédéric Le Play et Émile Durkheim, assure que le progrès industriel possède comme revers un déclin de la coopération et une hausse de l’hostilité entre les groupes. Pourquoi ? Mayo attribue l’origine de cette carence au décalage existant entre l’évolution technique et le développement des compétences sociales ; si la révolution industrielle apporta son lot d’innovations, matérielles et organisationnelles, les sciences humaines quant à elles manquèrent à leur mission de formation d’hommes capables de vivre dans ce nouveau type de société. Si bien que l’homme contemporain se trouve inadapté à son nouvel environnement, ce qui ne manque pas d’amener frustrations et conflits. Voici pourquoi « collaboration in an industrial society cannot be left to chance […] can such neglect lead to anything but disruption and catastrophe » (Mayo, 1975, p. 8-9). L’industrie ayant brisé les cadres traditionnels et naturels de la coopération, il convient de prendre en main le processus de collaboration faute de quoi la société pourrait s’acheminer vers sa dissolution et sa disparition.
L’extension mondiale du projet managérial
Cependant, pour l’ingénieur américain, loin de se limiter à prodiguer ses bienfaits à l’usine et à l’entreprise, la mise en application du management scientifique doit s’étendre au monde entier (« to the whole world in general » (Taylor, 1998, p. 74)). Quant à Elton Mayo, dès l’introduction de The Social Problems of an Industrial Civilization, il tient les propos suivants : « Most of us believed, or at least hoped, that the League of Nations at Geneva had set to work seriously, and with humility, to substitute peace and wisdom for war and national self-assertion. The problems of industry did not seem to imply any covert threat to constitutional methods of reform. There was no expectation of a barbarian attack upon the foundations of civilization » (Mayo, 1975, p xlvii-xlviii). Nous y lisons le désir de paix, mais découvrons en outre la mise en accusation des nations qui, par leur volonté belliciste et leur droit souverain, ont entrepris des guerres barbares qui ont ébranlé les fondements mêmes de la civilisation. Mais, chose plus inattendue et très intéressante, Mayo opère la mise en relation du politique et de l’industrie : nul se ne serait en effet douté que les progrès accomplis par la science, fleuron de la culture, viennent à menacer les bases de la société humaniste ; qui eût cru qu’un fruit puisse engendrer le déracinement de l’arbre ? Et comment expliquer qu’un tel malheur s’abattît sur le continent européen ? Le psychologue industriel étend alors le raisonnement qu’il portait sur l’atelier à l’échelle des nations : le décalage entre le progrès technique et les compétences sociales (c’est-à-dire la coopération), qui permettent de maîtriser ces évolutions fulgurantes, se trouve directement à l’origine des massacres industriels du XXe siècle : « If our social skills had advanced step by step with our technical skills, there would not have been another European war : this is my recurrent theme » (Mayo, 1975, p. 21). Mayo énonce alors une dichotomie entre deux types d’organisation : il y aurait d’une part les sociétés dans lesquelles règnent l’ordre établi (« established society ») et d’autre part les sociétés adaptatives (« adaptive society ») (Mayo, 1975, p. 11) ; formulé en des termes poppériens, d’un côté les sociétés fermées, de l’autre les sociétés ouvertes. Les premières s’illustrent par les tribus que l’anthropologie étudie et qui vivent, machinalement, inlassablement, selon les mêmes codes, les mêmes routines, les mêmes rites : leur culture est en quelque sorte devenue une seconde nature, une norme parfaitement intériorisée, un instinct. Tout au contraire, les secondes, qui sont le produit de la Révolution Industrielle, se caractérisent par le changement et la nécessité de l’adaptation permanente. De telle sorte que la typologie de Mayo annonce en réalité une thèse historique, car, à l’époque moderne, les sociétés adaptatives ont remplacé de façon irréversible les sociétés établies.
Dans le recueil d’articles qu’est Organization and Management, Chester Barnard retranscrit des considérations sur « la planification en vue d’un gouvernement mondial » (« On planning for world government ») prononcées en 1944 lors d’une conférence. Et, inévitablement, le point de départ demeure identique : « To maintain world peace, it is now generally supposed, calls for some system of improved world government or organization » (Barnard, 1949, p. 135). Puisqu’un tel système, comme tout système, peut agir aveuglément et en fin de compte provoquer des dégâts, il convient d’introduire au sein des organisations formelles une différenciation dichotomique, et fait de cette dualité l’enjeu décisif de la marche du monde : « The choice between them is today a most acute problem in economic, social, and political fields whether of world-wide or of narrower scope » (Barnard, 1949, p. 150). D’un côté, les organisations « latérales » reposent sur un effort coopératif consigné dans des règles écrites et/ou orales ; leur structure est de type horizontal car elles privilégient les relations humaines, bi- ou multi-latérales. De l’autre côté, les organisations « scalaires », qui se révèlent fondamentalement autoritaires, jouent de la prescription, du commandement et de l’obéissance pour atteindre les objectifs assignés. L’assimilation parfaite entre forme organisationnelle et régime politique est alors réalisée : « Lateral organization are « policed » by public opinion, by the « moral community », by custom and habit and social institutions, by the effect of violation of agreement on the future interest of the violator, for example, vis-à-vis future potential agreements. They are also policed by courts and other police authorities. Scalar organization, on the other hand, has to develop and maintain its internal discipline itself, sometimes establishing special police arms to aid in so doing » (Barnard, 1949, p. 152). Ainsi, dans la lignée de Mayo, dont il connaît parfaitement les travaux, Barnard formule ici le raisonnement néoconservateur dont l’importance sur la géopolitique mondiale se fait encore sentir aujourd’hui. Cette pensée met en scène un manichéisme qui sépare les démocraties des régimes autoritaires, mais appréhende ces catégories politiques avec les prismes de la morale (« la paix » et les droits de l’homme) et du management (la démocratie est un système ouvert ou, dans les écrits de Barnard, une organisation latérale). Logique pour le moins suspecte, qui procède par métabase – saut injustifié d’un domaine à l’autre –, et que l’on retrouvera chez les acteurs du Tavistock Institute à travers l’école sociotechnique (Rappin, 2014, p. 88-93). Elle conduit, ni plus ni moins, à modeler un nouvel ordre mondial au nom de la paix : « It is evident that in so far as world organization could be achieved by deliberate choice of forms of organization, the choice between lateral organization and scalar organization is the primary question. » (Barnard, 1949, p. 152). Par voie de conséquence, l’ordre mondial pacifié résulte de la mise en œuvre d’organisations latérales, car ces dernières ne sont rien de moins que la garantie que l’esprit démocratique s’impose en tous lieux du globe. La cybernétique, qui a lancé le management dans l’ère de l’information et du savoir (Rappin, 2014) s’inscrit fidèlement dans cette lignée en mettant l’accent sur la communication et la circulation de l’information, dimensions optimalisées lorsque l’organisation n’est pas rigide et qu’elle secrète des phénomènes d’apprentissage (Wiener, 2014, p. 297 sq).
La géopolitique du management
On pourrait croire, à découvrir de tels fondements pacifistes, que le management relève de l’anti-géopolitique : en condamnant toute forme de rapport antagoniste au nom d’une utopie de la coopération qui doit prendre place tant dans l’organisation qu’au niveau mondial, il porterait un projet dont les fondements neutraliseraient ceux de la géopolitique, la puissance, le conflit, le polemos. Le général Lucien Poirier (1982, p. 40) met justement en exergue l’anesthésie qui guette le concept de stratégie lorsque cette dernière se trouve absorbée dans le giron du management (et devient alors « management stratégique ») : « La volonté de rationalité se traduit par un foisonnement d’études sur les techniques d’action et de décision. Ces travaux font appel à un outillage intellectuel hétéroclite et aux ressources encore mal explorées. Il s’étend, par exemple, de la logique à la cybernétique en passant par le « management », les théories économiques, la théorie générale des systèmes, la théorie des jeux, le « system analysis », l’analyse coût-avantage et les techniques d’optimisation, les instruments mathématiques de la programmation, les graphes, l’informatique, sans oublier, bien entendu, la stratégie comprise dans un sens de plus en plus élargi : on tend à négliger les notions de conflit et d’adversaire, et à réduire la stratégie à l’art de la décision rationnelle. Extension abusive du concept de stratégie puisqu’elle évacue ce qui en fait le principe : la dialectique de l’Un et de l’Autre, de l’identité et de l’altérité ». Il ne convient guère, toutefois, d’en rester à ces principes philosophiques trop abstraits, et nous devons assurément les mettre en relation avec le contexte historique pour leur donner leur plein sens : envisageons alors d’une part, la période de la guerre froide ; et d’autre part, l’effondrement du bloc soviétique et du monde bipolaire. Parce qu’il est énoncé à partir d’un lieu et d’une situation contingente, tout universel contient sa part de particularité qui révèle le projet qu’il tient pour évident et allant de soi.
Publié initialement en 1999, l’ouvrage Who Paid the Piper ? de Frances Stonor Saunders (2003) fit grand bruit car il révéla au grand public un aspect tout à fait méconnu de la guerre froide : sa dimension culturelle. Plus particulièrement, l’auteur montre que les États-Unis, pour s’assurer que l’Europe ne sombre pas du côté de l’URSS et du communisme, mirent en place un véritable plan de colonisation de l’imaginaire de l’Ancien Monde. Ce programme fut directement piloté par la CIA, agence créée en 1947, et embarqua, parfois de plein gré mais souvent à leur insu, des scientifiques, des artistes, des intellectuels, des journalistes, etc., dans une opération de conquête culturelle qui consiste à faire adopter à sa cible un point de vue prédéfini en lui faisant croire que cette adhésion provient de son propre fait. L’art contemporain se révèle tout à fait paradigmatique de la stratégie culturelle américaine ; Frédéric Martel (2011) en retrace avec force détails l’histoire et en expose l’argument : abstrait et déconnecté de toutes tradition, l’art contemporain rompt non seulement avec le réalisme matérialiste soviétique, mais aussi avec toutes les références traditionnelles de l’Europe, promouvant ainsi de la sorte la possibilité d’un Nouveau Monde dont les États-Unis sont la personnification même.
L’idée que la guerre se déroule désormais moins au niveau militaire – dissuasion nucléaire oblige – qu’aux plans cognitif et culturel, ceux des représentations individuelles et collectives, se renforce encore après la disparition du bloc soviétique. En 1990, Joseph Nye, le célèbre géopoliticien américain, entreprend de répondre à tous ceux qui prétendent que les États-Unis connaîtraient une phase de déclin ; non seulement n’en va-t-il pas ainsi, mais il est en outre inscrit dans la mission voire dans la nature de ce pays de diriger le monde : Bound to lead est ainsi le titre significatif de l’ouvrage de Nye (1990). Robert Kagan, quant à lui, souligne, dans une forme explicite de chantage duquel nous sommes désormais bien coutumiers, que le retrait des États-Unis de la scène internationale signifierait ni plus ni moins que l’effondrement de l’ordre libéral et le recul de la démocratie : « Quels seraient les effets d’une nouvelle donne qui remplacerait la prédominance américaine par un monde fondé sur une parité relative entre les puissances ? Les intellectuels qui se piquent de politique étrangère et qui nous annoncent un monde « post-américain », qu’il soit multipolaire ou, comme le disent certains, « non polaire », imaginent que l’ordre libéral mondial subsisterait en gros dans sa forme actuelle. Beaucoup supposent qu’une différente configuration du pouvoir dans le système international ne produirait pas nécessairement un ordre moins libéral et moins ouvert. […]
Ce discours repose sur des suppositions que rien ne permet aujourd’hui de vérifier » (Kagan, 2012, p. 107-108). Il est toutefois certain que l’ordre mondial issu de la Seconde Guerre Mondiale chancèle et qu’en plus d’un réaménagement des relations internationales se font jour un certain nombre de transformations du pouvoir ; et comme le note Nye (1990, p. 175), « the problem for the United States will be less the rising challenge of another major power than a general diffusion of power ». C’est la raison pour laquelle le leadership américain ne pourra se maintenir qu’en maîtrisant ces mutations : mais quelles sont-elles au juste ? Elles consistent principalement dans ce mouvement de relativisation du facteur militaire qui désormais cohabite avec les instruments de communication, les compétences organisationnelles et la manipulation des interdépendances (Nye, 1990, p. 180). Bref, il s’agit de ce que Nye nommera ultérieurement le soft power, ce pouvoir mou et doux caractéristique de la société globale de l’information, qui consiste à obtenir ce que l’on souhaite en usant de mécanismes d’attraction plutôt que de procédés de sanction : en effet, pour le dire avec les termes de l’auteur, « le soft power repose sur la capacité à dessiner les préférences d’autrui » (Nye, 2004, p. 5). En d’autres termes, l’époque contemporaine connaît bien sûr encore la guerre par les armes, plus précises et plus destructrices que jamais, mais elle voit se développer de façon exponentielle le versant cognitif du combat : la guerre psychologique qui, quand elle prend pour terrain de jeu et d’expérimentation la civilisation elle-même, devient guerre anthropologique, lutte pour (ou contre) l’identité culturelle.
C’est bien dans ce contexte qu’il s’agit de replacer le management et de penser ce dernier comme géo-management. Certes, ses concepteurs (ceux présentés ici : Taylor, Mayo, Barnard, liste évidemment non exhaustive) établissent une tierce voie, celle de la coopération, qui échappe aussi bien à la conflictualité socialiste qu’à la concurrence libérale. Toute violence semble exclue de cette utopie. Mais cet ordre du monde, que l’on désigne aujourd’hui du nom de « gouvernance », « produit d’un monde convaincu d’être pacifié » (Moreau Defarges, 2003, p. 50), est à construire et à imposer car il échappe bien évidemment à toute génération spontanée. Le management se révèle ainsi être par voie de conséquence la vision américaine des affaires humaines, que celles-ci concernent le travail dans l’entreprise ou les relations entre les acteurs internationaux. Imposer cet imaginaire revient ainsi à déployer le management dans le cadre de la guerre cognitive et culturelle.
Plus encore, les fondements du management doivent nous conduire à prendre en considération son projet géopolitique sous-jacent : laisser accroire aux nations que l’ordre du monde ne requiert plus l’exercice de la puissance. Kagan, feignant d’ignorer le rôle historique des États-Unis dans cet état de fait, écrivait lui-même, en 2003, que « l’Europe est en train de renoncer à la puissance ou, pour dire la chose autrement, elle s’en détourne au bénéfice d’un monde clos fait de lois et de règles, de négociation et de coopération internationales » (Kagan, 2003, p. 9). L’Amérique, berceau du management, parvient à suivre la religion de l’efficacité sans renoncer à la puissance et au rayonnement de sa civilisation ; la Russie et la Chine, bientôt l’Inde, jouent désormais les premiers rôles sur la scène internationale ; l’Europe, quant à elle, s’enfonce et s’engonce dans une haine de soi et une acceptation d’un éternel devenir-autre qui en font le terrain privilégié de l’expérimentation géo-managériale.
BIBLIOGRAPHIE
C. Barnard (1949), Organization and Management, Cambridge, Massachussetts, Harvard University Press, 244 p.
D. Golsorkhi, I. Huault et B. Leca (dir.) (2009), Les études critiques en management. Une perspective française, Québec (Canada), Les Presses Universitaires de Laval, 476 p.
R. Kagan (2003), La puissance et la faiblesse. Les États-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre mondial, trad. Fortunato Israël, Paris, Plon, 168 p.
R. Kagan (2012), L’ordre mondial américain. Les conséquences d’un déclin, trad. Frédéric Ferney, Paris, 216 p.
F. Martel (2011), De la culture en Amérique, Paris, Flammarion, « Champs essais », 848 p.
E. Mayo (1975), The social problems of an industrial civilization, London, Routledge & Kegan Paul, « International Library of Sociology ».
P. Moreau Defarges (2003), La gouvernance, Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 128 p.
M. Motte (1995), « Une définition de la géostratégie », Stratégique, 1995, n°58, p. 85-120.
J. Nye (1990), Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, New York, Basic Book, 310 p.
J. Nye (2004), Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York, PublicAffairs, 192 p.
L. Poirier (1982), Essais de stratégie théorique, Paris, Stratégique, 384 p.
B. Rappin, Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, Volume 1, Nice, Ovadia, « Chemins de pensée », 240 p.
J. Rojot (2003), Théorie des organisations, Paris, Éditions Eska, 534 p.
F. Stonor Saunders (2003), Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle, trad. D. Chevalier, Paris, Éditions Denoël, « Impacts », 512 p.
F. W. Taylor (1998), The principles of scientific management, Mineola, New York, Dover Publications, 76 p.
F.-X. de Vaujany, A. Hussenot et J.-F. Chanlat (dir.) (2016), Théories des Organisations. Nouveaux tournants, Paris, Economica, 588 p.
N. Wiener (2014), La cybernétique. Information et régulation dans le vivant et la machine, trad. R. Le Roux, R. Vallée et N. Vallée-Lévi, Paris, Seuil, « Sources du savoir », 376 p.

Mots-clés
compétitivitéConditions de travail
économie et histoire
géoéconomie
géopolitique
gouvernance
Industrie
puissance
Questions de « sens »
mondialisation
Relations internationales
Société
Etats-Unis
Europe
HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
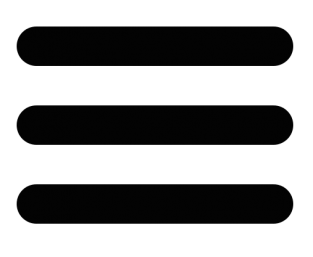

 GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
 LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER
LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER